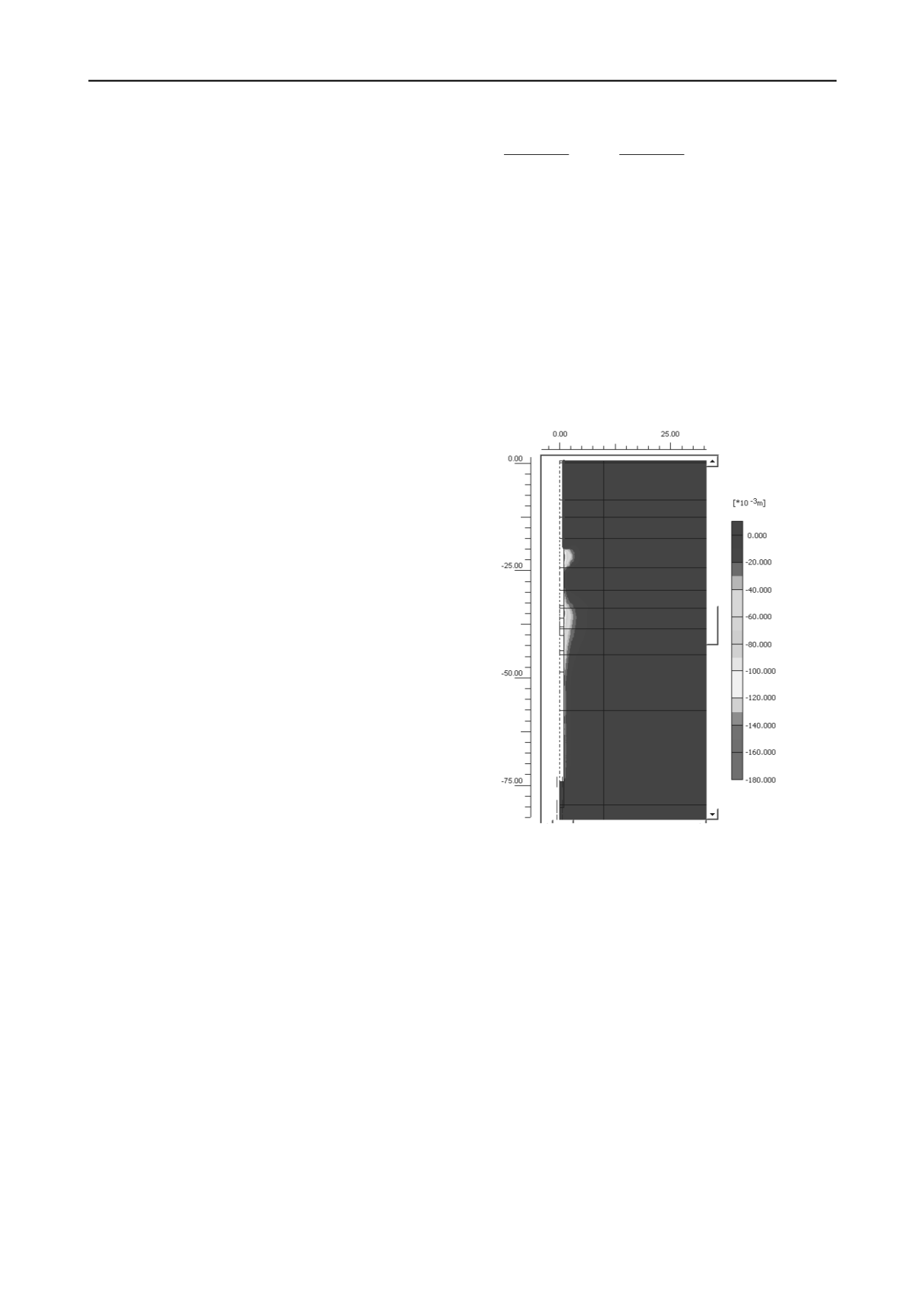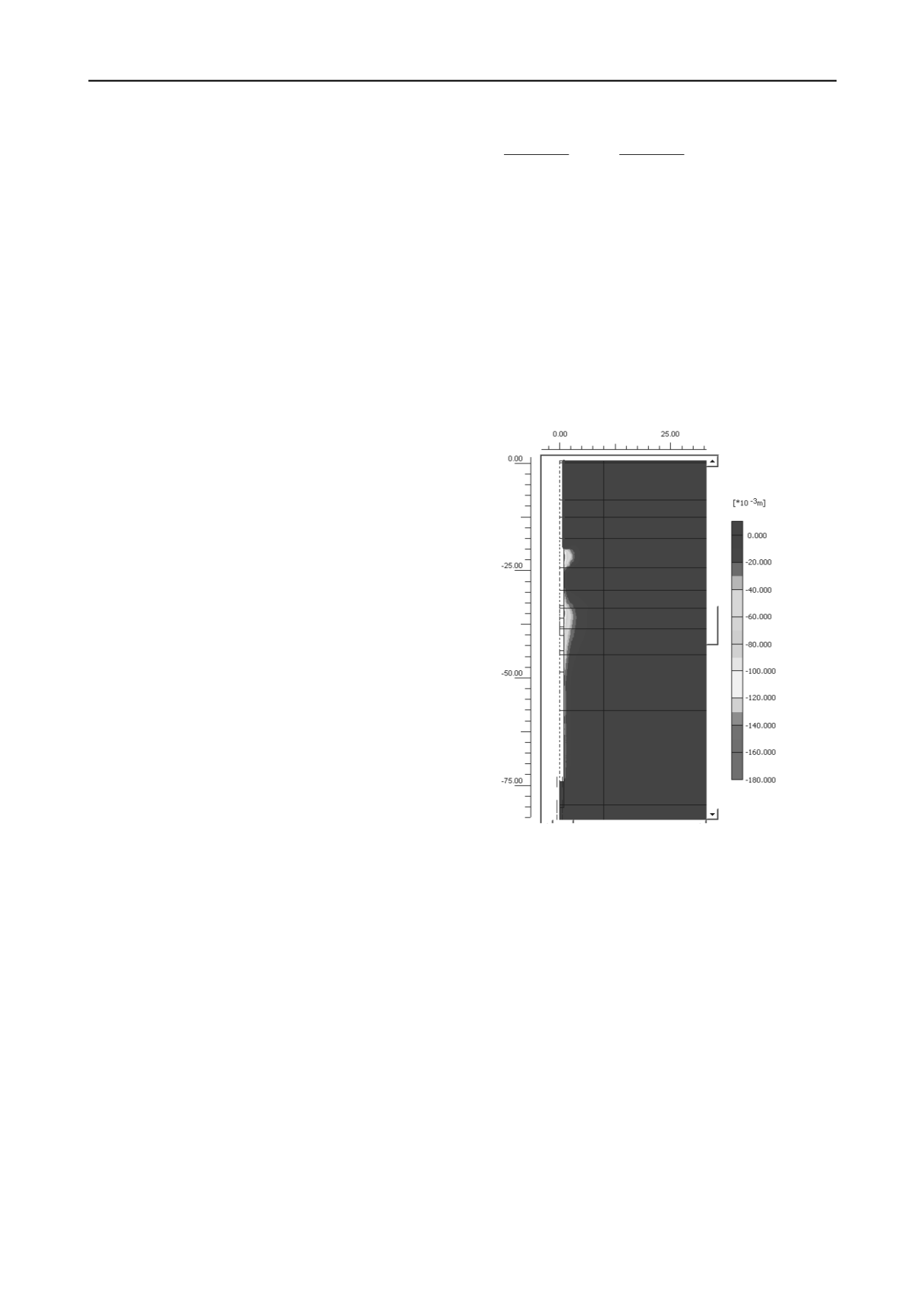
2906
Proceedings of the 18
th
International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013
adaptée pour cette profondeur, sous confinement d’une
boue bentonite.
-
Jusqu’à 100 m, il était prévu l’utilisation du système
RCD (Revese Circulation Drilling). Cette méthode
consiste à descendre un outil à lames multi-formes à trois
faces triangulaires et à attaque ponctuelle du sol. Le train
de tige est constitué d’une tubulure creuse et une masse
poids afin de maintenir la verticalité du forage. Le train de
tige est actionné par une table de rotation hydraulique
posée sur la tête du pieu. Le « cuttings » est envoyé par la
voie de tubulure centrale moyennant une pression d’air
comprimé envoyée depuis la surface. Cette méthode
s’apparente à la technique d’air-lift utilisée souvent pour
le pompage ou bien parfois pour le nettoyage de fond de
forage.
Lors du forage du premier pieu (pieu G de la pile P12),
après avoir atteint 33m le premier jour au bout de 8h avec la
technique du « bucket », une certaine déviation de la
verticalité a été constatée, ce qui a nécessité le recourt à une
correction moyennant le RCD. Le changement de technique
de forage et la mise en œuvre de la circulation inverse se sont
traduits par de nombreuses difficultés et modifications sur
l’outil. La profondeur de 50 m n’a pu être atteinte qu’au bout
de 8 jours, mais par la suite la profondeur de 76m a pu être
atteinte en quelques heures. Cependant à partir de cette
profondeur, l’argile compacte et collante s’est mise à obstruer
l’orifice d’aspiration, de telle sorte que, après plusieurs
tentatives et modifications, le forage a été arrêté à 79,5 m . A
ce stade, en attente de prise de décision, le forage a été
comblé par de la grave concassée (5/8mm) jusqu’à 13 m de la
surface. Ce temps d’attente a permis de reprendre les calculs
afin d’étudier l’opportunité de limiter la profondeur des
pieux.
Ainsi, on conclut que la méthode de forage classique au-
delà de 33m a montré des problèmes de maintien de la
verticalité du forage. Cette difficulté est due à la longueur du
« kelly », et du jeu qui pourrait avoir lieu entre les éléments
télescopiques notamment sous l’effet du poids important du
« buket » de 2m de diamètre. Cet aléa est accentué par le
manque de stabilité de la plateforme de travail, mise en place
sur le terrain support constitué de vase molle. Puis, la
méthode de circulation inverse a permis de corriger la dérive
du forage par rapport à la verticale. C’est pour cette raison
qu’il a été décidé de la conserver en dépit des difficultés
apparues.
Figure 3. Déformation horizontale de la paroi du forage (max
174 mm)
3.1
Déplacements des parois du forage durant et après
l’excavation d’un pieu
Le profil et diamètre du forage ont été contrôlés à chaque
étape, par des mesures au « KODEN », qui donnent les
déformations en plusieurs points de la circonférence du
forage, mesurées en continue le long du forage. Il a été
constaté un resserrement de l’ordre de 25cm maxi sous boue
bentonitique.
Nous avons procédé à des simulations de cette
déformation moyennant un calcul EF avec le logiciel Plaxis
afin de déterminer un ordre de grandeur des déplacements de
la paroi du forage terminé et rempli de bentonite, puis par de
la grave concassée, dans les deux cas :
-
à court terme juste après l’excavation ;
-
à long terme une fois que toutes les surpressions
interstitielles dans les argiles autour de la paroi se sont
dissipées.
La déformation de la paroi est simulée dans le modèle
numérique de calcul à partir du module d’élasticité E :
-
à court terme E a été déduit du module pressiométrique
EM (Combarieu 2006) ;
-
à long terme E a été déduit de l’indice de gonflement au
déchargement C
s
mesuré par les essais oedométriques
(module consolidation de Plaxis).
)e (1 2.3
Cc *
0
;
)e (1 2.3
Cs 2 *
0
(1)
avec C
c
/C
s
=10
Les calculs EF d’un modèle axisymétrique (Figure 3),
donnent des valeurs faibles du déplacement de la paroi à court
terme (de l’ordre du cm à quelques cm au plus). En revanche,
à long terme les valeurs de ce déplacement dans les argiles
sont beaucoup plus fortes : 18 cm au maximum dans la partie
supérieure de la couche V et en moyenne 10 cm dans la partie
moyenne de la même couche V.
Le calcul pour les différentes phases, indique que le pieu
aurait subi une déformation maximale de 4 cm environ après
un jour d’attente sous confinement par de la boue
bentonitique. Elle concerne la partie supérieure de la couche
V pour laquelle le déplacement maximal à très long terme est
de 18cm, sous confinement par de la grave concassée.
Tous ces calculs, dont les résultats sont obligatoirement très
approximatifs, montrent que le forage de grand diamètre dans
l’argile, peut subir, durant la période de confinement sous
boue, des déplacements non négligeables suite au mécanisme
de relaxation du sol encaissant. Aussi, dans ces conditions, on
comprend que, si la période de forage du pieu sous boue est
trop longue, les couches compactes subjacentes (sable IV)
peuvent présenter un risque d’éboulement.
3.2
Effet de la relaxation du sol encaissant sur la portance
du pieu isolé
Afin de vérifier si la portance du pieu dont le sol encaissant
aurait subi une altération, nous avons supposé que ceci a un
effet direct sur le terme de frottement latéral q
s
qui est
fonction de la pression limite de terrain P
l
. Le terme de pointe
a été considéré peu affecté. Par mesure de sécurité, il a été
recommandé de procéder à des travaux d’injection de la
pointe.
Ainsi, le pieu G de la pile P12, a fait l’objet d’une
reconnaissance complémentaire basée sur un sondage
pressiométrique réalisé à proximité immédiate du pieu et un
deuxième sondage un peu plus loin dans une zone supposée
non affectée. Une étude paramétrique reliant un facteur de