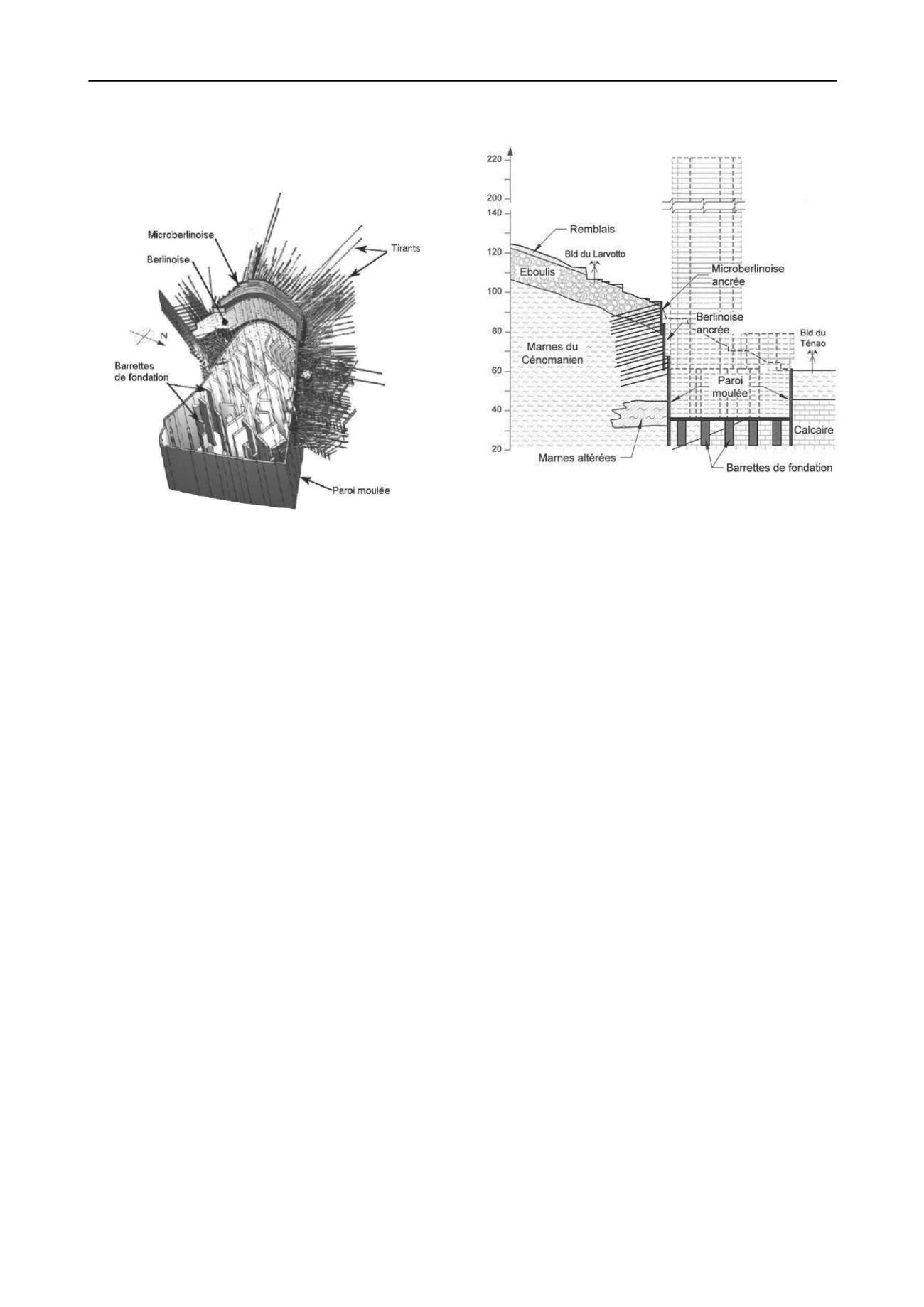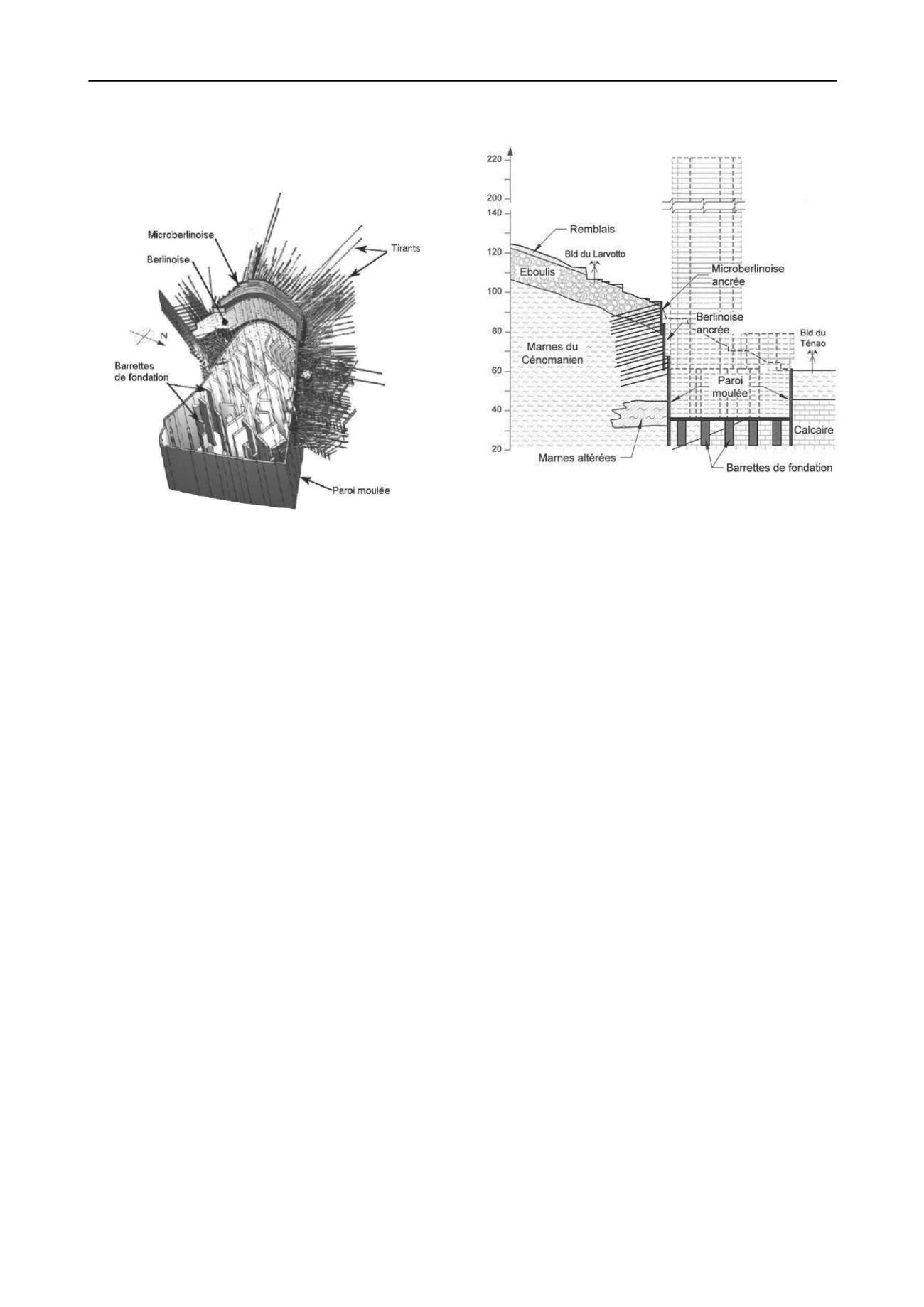
1992
Proceedings of the 18
th
International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013
Ente les cotes 110.0 NGM et 64.0 NGM, les berlinoises et la
partie supérieure de la paroi moulée sont ancrées par 18 lignes
de tirants de longueur maximum 42 m.
Figure 1 : Vue 3D des soutènements et fondations
A la cote 64.0/67.0 NGM, la dalle de couverture du parking
est coulée, après quoi la construction de la tour en up & down
peut débuter : il s’agit de construire simultanément la
superstructure et l’infrastructure, à raison de trois étages de
superstructure pour un niveau d’infrastructure en taupe, la paroi
moulée et ses contreforts prenant appui sur les dalles de sous-
sols coulées à l’avancement et portées par les barrettes de
fondations préfondées.
2.2
Le contexte géotechnique
Géologiquement la structure tectonique régionale est complexe :
l’ensemble du versant est constitué d’un système d’écailles, et
au droit du site on rencontre des marnes Cénomaniennes. Ces
dernières, qui ont déjà été à l’origine de difficultés lors de la
réalisation de grandes excavations à Monaco, constituent
l’essentiel des terrains à excaver, avec localement un substratum
calcaire, qui remonte à la faveur d’une faille. Notons que la
faille du Larvotto se situe légèrement en aval du site.
Le site a fait l’objet d’une importante reconnaissance, avec
environ 35 sondages, carottés, destructifs et pressiométriques,
sur des profondeurs atteignant couramment 90 m, et jusqu’à
120 m. La Figure 2 montre une coupe transversale, mettant en
évidence la couche de colluvions épaisse de 25 m en amont du
site, puis les marnes du Cénomanien, plus ou moins
déstructurées, et localement les calcaires profonds.
On notera tout particulièrement la présence de niveaux
décomprimés dans les marnes, mis en évidence par leur
description sur carottes et par des modules pressiométriques très
faibles (< 50 MPa), alors qu’ils sont de l’ordre de 200 à
300 MPa dans les marnes saines. Cette conséquence probable de
la tectonique du site a été l’un des enjeux importants du projet
de soutènement.
L’hydrogéologie montre une nappe de surface dans les
éboulis, suivant la pente à 15-20 m sous le TN et une nappe
captive en charge dans les calcaires profonds. Mais les capteurs
de pression interstitielle dans les marnes montrent également
des valeurs de pression correspondant à la nappe de surface, et
ce au moins localement et temporairement : la conception du
projet a du également tenir compte de ces fortes charges
piézométriques.
Figure 2 : Profil géologique et projet
2.3
La conception des soutènements et fondations
La hauteur importante de la tour, et les actions qui en résultent
sur les fondations sous l’effet du vent et du séisme, ont nécessité
une étroite liaison entre les études de la structure et des
soutènements. En effet, la paroi moulée périphérique fonctionne
à la fois comme soutènement des terres et comme fondation de
la tour. Les effets de renversement sur la tour, notamment sous
séisme, mettent en traction la paroi moulée amont. Par ailleurs,
en phase de service, la tour doit être calculée sous l’hypothèse
d’une détente des tirants des berlinoises, les massifs de terre
s’appuyant directement sur le socle de la superstructure.
Pour ces diverses raisons, les soutènements ont fait l’objet de
plusieurs vérifications. En phase d’excavation, ils ont été
dimensionnés par la méthode classique des calculs au
coefficient de réaction, complétée par des calculs de stabilité
générale faisant intervenir la longueur des tirants. L’ensemble a
été conduit selon des profils transversaux bidimensionnels,
malgré le caractère fortement tridimensionnel du projet,
conduisant à une approche a priori sécuritaire.
En phase de service, pour vérifier le comportement de la
paroi moulée associée à la tour, un modèle 3D structurel des
infrastructures a été élaboré, sur lequel ont été appliquées les
poussées issues des calculs de soutènement au coefficient de
réaction, et les actions propres à la tour (vent, séisme, charges
verticales). Afin de prendre en compte l’effet des phases de
terrassement sur les sollicitations finales dans la paroi moulée, il
a été également introduit un cas de charge élémentaire
représentant le décalage de moment et d’effort tranchant dans la
paroi entre un calcul phasé et un calcul non phasé négligeant les
terrassements. Le modèle de l’infrastructure ainsi étudiée
fournit les cartographies d’armatures à prendre en compte dans
le dessin des cages de paroi moulée et conduit à un
dimensionnement rigoureux et optimum.
La méthodologie de construction de la tour en up & down
permet d’assurer la stabilité générale et de maîtriser au mieux
les modifications de contraintes dans le massif. En effet :
-
En phase de terrassement, le poids de la tour compense
partiellement le poids des terres excavées qui sont
stabilisatrices vis-à-vis des cercles de grand glissement ;
-
Les tassements se produisent au fur et à mesure de la
construction et sont compensés par le soulèvement du fond de
fouille.
Enfin, malgré le caractère de roche tendre des terrains, un
clouage vertical en fibres de verre a été nécessaire devant la
paroi moulée amont, afin d’améliorer la butée mobilisable lors
des dernières passes de terrassement où la paroi est soumises à