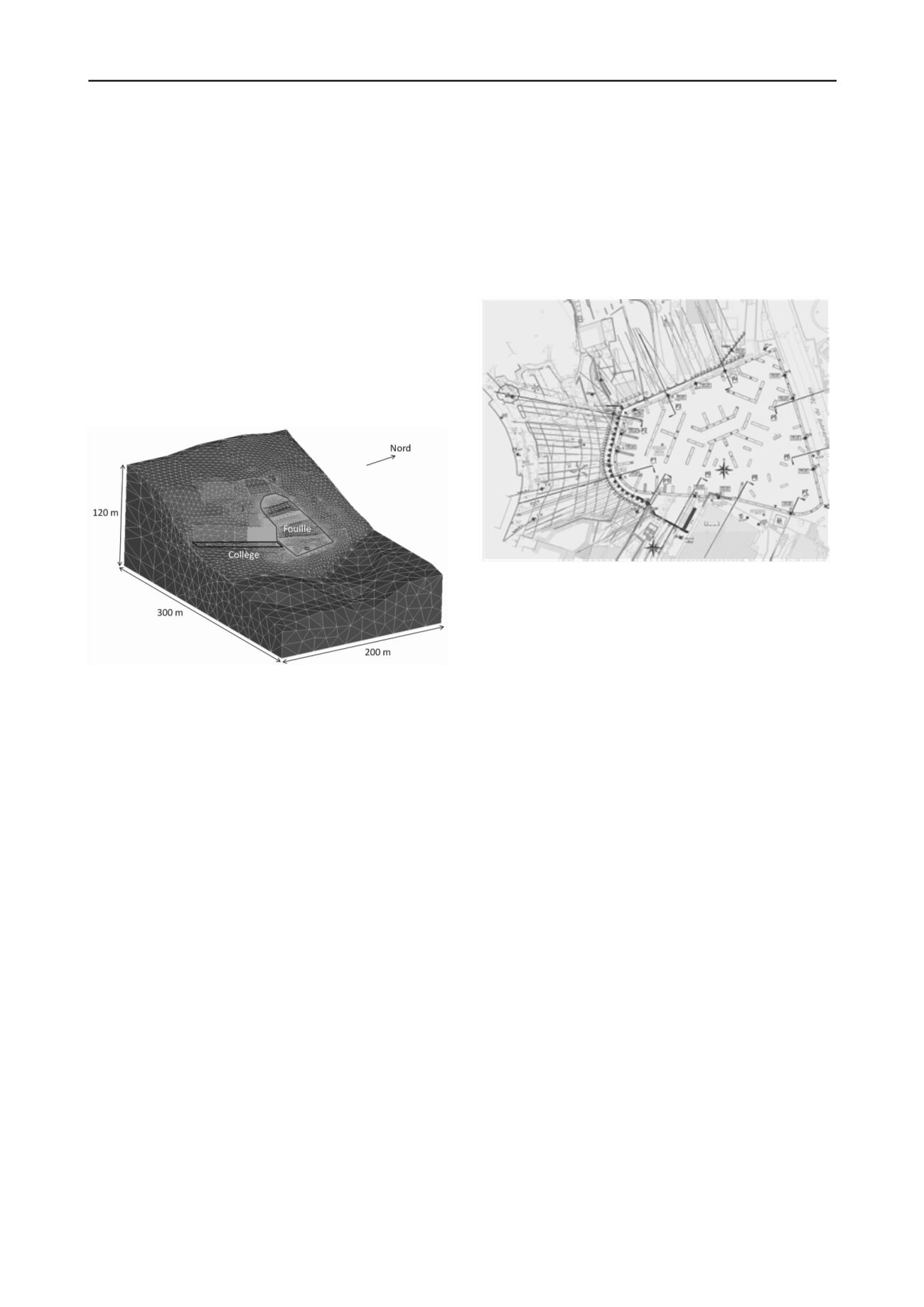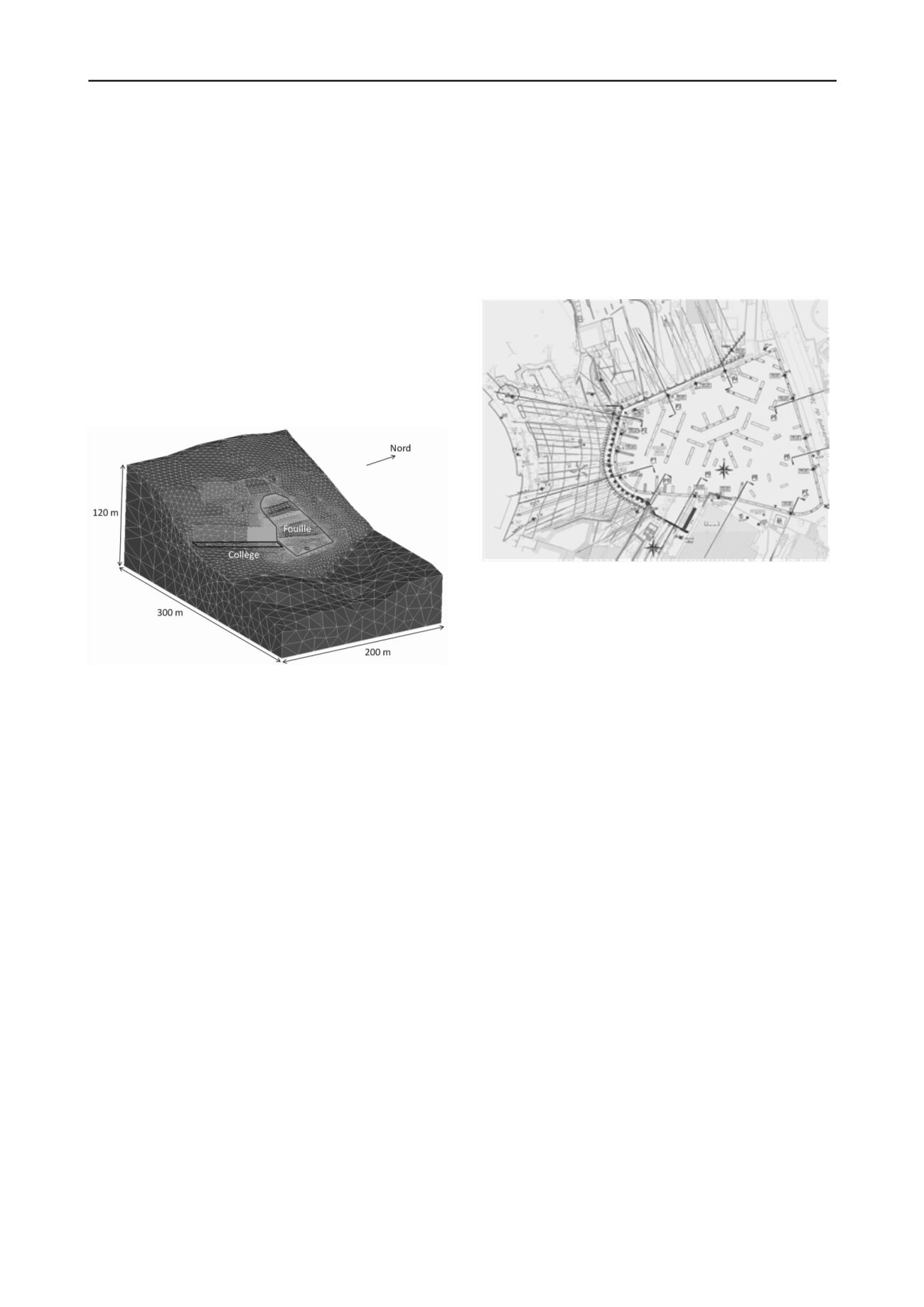
1993
Technical Committee 207 /
Comité technique 207
une poussée approchant les 1000 kPa dans les zones de marnes
altérées.
3 LES MODÉLISATIONS NUMÉRIQUES
3.1
Modélisation 3D globale sous CESAR 3D
Après un premier modèle géotechnique tridimensionnel réalisé
par Coyne et Bellier dans le cadre des études de conception,
nous avons conduit, dès le démarrage des études d’exécution,
une nouvelle modélisation géotechnique 3D de l’ensemble du
projet, intégrant les interfaces géologiques, les avoisinants
existants et les nouvelles infrastructures, réalisée avec
CESAR 3D v5. Le modèle (Figure 5) comporte 57 phases de
calcul reproduisant toutes les étapes des travaux depuis
l’excavation des premières plateformes jusqu’à l’application des
charges de superstructures sur les barrettes de fondations.
Figure 3 : Vue du modèle 3D général
Les résultats mettent en évidence l’effet de voûte lié à la
forme de l’excavation et conduisent à des déplacements des
avoisinants de l’ordre de 5 mm en déplacement horizontal, et
presque toujours inférieurs à 5 mm en soulèvement. Les
déplacements calculés les plus importants sont situés près du
collège Charles III.
3.2
Modélisation 3D locale sous Plaxis 3D
Suite à un changement de méthode pour réaliser les
soutènements au niveau du collège, un autre calcul centré sur ce
bâtiment a été réalisé avec Plaxis 3D. Ce modèle « simplifié »
(Figure 4) ne comprend que les structures existantes du collège,
la variante de soutènement, et une moitié de l’excavation
principale. La stabilité de l’ensemble est assurée par les
conditions aux limites, et l’effet de voûte est reproduit par une
surcharge à l’arrière du modèle.
Les déplacements calculés restent comparables à ceux
obtenus précédemment et montrent que la nouvelle solution de
soutènement garantit bien la stabilité de l’ensemble.
3.3
Apport des modélisations
Ces modélisations 3D ont permis la prise en compte des
effets 3D tels que l’effet de voûte et la validation de systèmes de
soutènement complexes, notamment vis-à-vis des déplacements
des structures et des avoisinants. Le comportement fortement
3D de l’ouvrage est bien mis en évidence, avec notamment des
déplacements des soutènements de l’ordre de 10 mm au
maximum, très inférieurs aux 30 mm évalués par les calculs 2D
au modules de réaction.
En outre, une approche de la stabilité générale a pu être
conduite sur la base du modèle global, en affectant les
paramètres de résistance au cisaillement des terrains de
coefficients réducteurs partiels, et en vérifiant l’équilibre
numérique du modèle avec ses caractéristiques réduites.
4 L’APPLICATION DE LA MÉTHODE
OBSERVATIONNELLE
4.1
Auscultation mise en œuvre
L’auscultation de l’ouvrage et de ses avoisinants est organisée
selon 10 profils verticaux (3 à l’amont côté ouest, 3 côté collège
au sud, 2 côté Nord et 2 à l’aval côté Est) tel qu’illustré sur
Figure 4. Sur chacun de ces profils, les différents instruments de
mesures permettent de recouper les informations.
Figure 4 : Vue en plan du projet et des profils d’auscultation
La mise en place du dispositif d’auscultation de l’ouvrage et de
ses avoisinants s’est faite de manière progressive :
-
En premier lieu, dès le début des travaux, les avoisinants
(villas et immeubles aux alentours, collège Charles III, paroi
moulée amont du collège) ont été équipés de cibles
topographiques ; des inclinomètres profonds ont été réalisés
dans le terrain (jusqu’à 80 m de profondeur) à l’amont et
autour de l’emprise de la future fouille, et une dizaine de
piézomètres a également été réalisée tout autour de la fouille ;
-
Puis les ouvrages ont été équipés au fur et à mesure de la
réalisation : mise en place d’inclinomètres noyés dans les
micropieux, pieux et paroi moulée, de cibles topographiques,
d’extensomètres de forages, de cellules dynamométriques en
tête de tirants, ainsi que de jauges de contraintes dans les
barrettes et certaines dalles. L’auscultation des avoisinants a
également été renforcée tout au long du chantier avec l’ajout
de cibles complémentaires et de fissuromètres dans les zones
ayant subi des déplacements au cours de travaux.
Pour les profils les plus hauts côté amont, 3 séries
d’inclinomètres sont placées en recouvrement relatif sur la
microberlinoise, la berlinoise et la paroi-moulée, de façon à
reconstituer un profil inclinométrique complet intéressant les
divers soutènements. Ils sont également équipés d’environ
7 cellules de charges sur les têtes de tirants, réparties sur les
18 lits.
Les cibles topographiques sont elles aussi disposées le long
des profils à raison d’une cible toutes les 2 passes de
terrassement soit environ une cible tous les 5 mètres, avec une
cible en tête de chaque ouvrage.
Les extensomètres de forage sont pour certains ancrés à une
profondeur de 60 m à l’arrière du soutènement, au-delà des
tirants les plus longs, avec une ancre tous les 10 m.
Inévitablement un certain nombre d’instruments situés dans
le terrain à l’amont du projet a été détruit au moment de la
réalisation des tirants de la berlinoise, et a dû être remplacé.
C’est notamment le cas des piézomètres, qui ont été remplacés
le plus souvent par des capteurs de pression interstitielle.