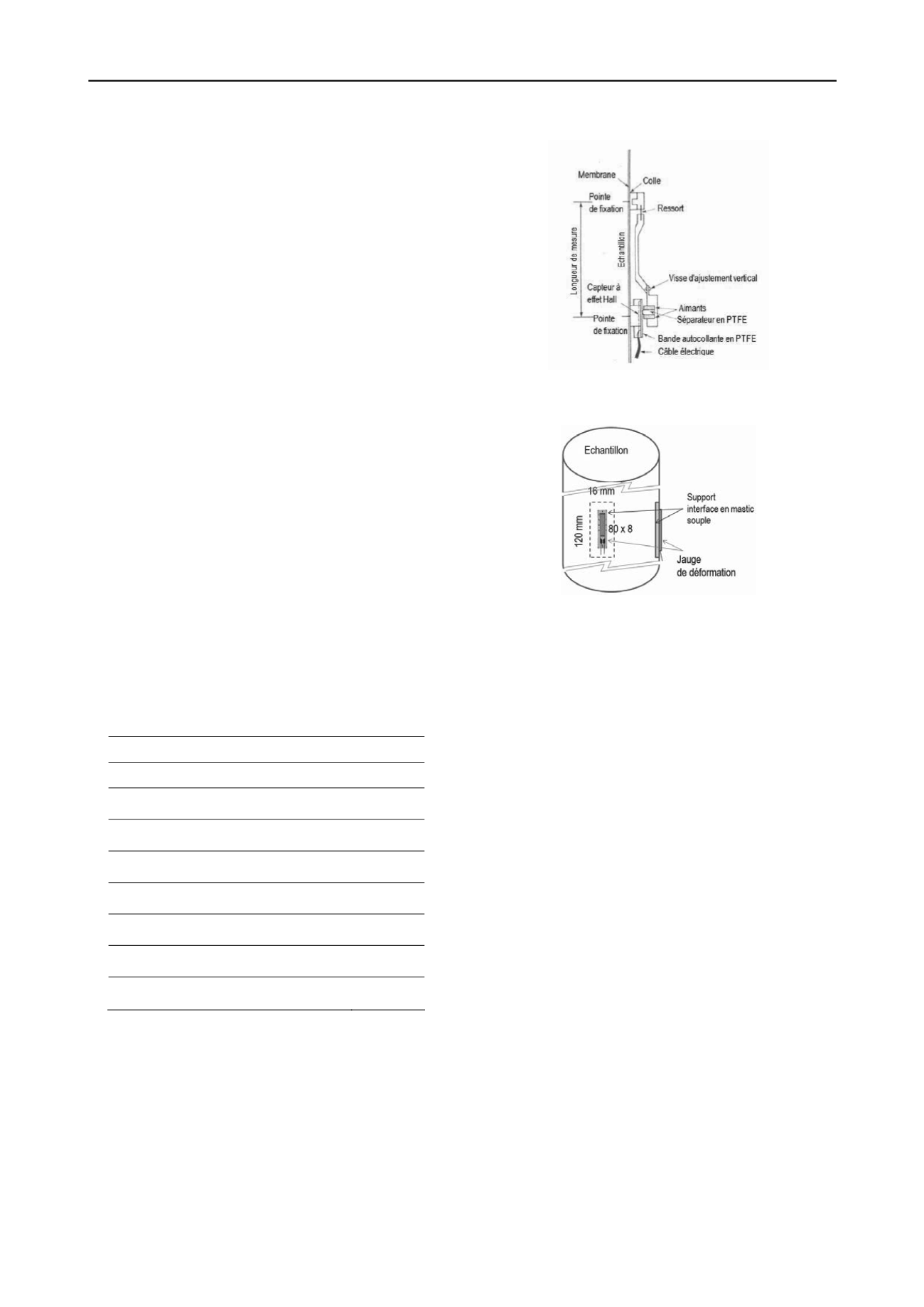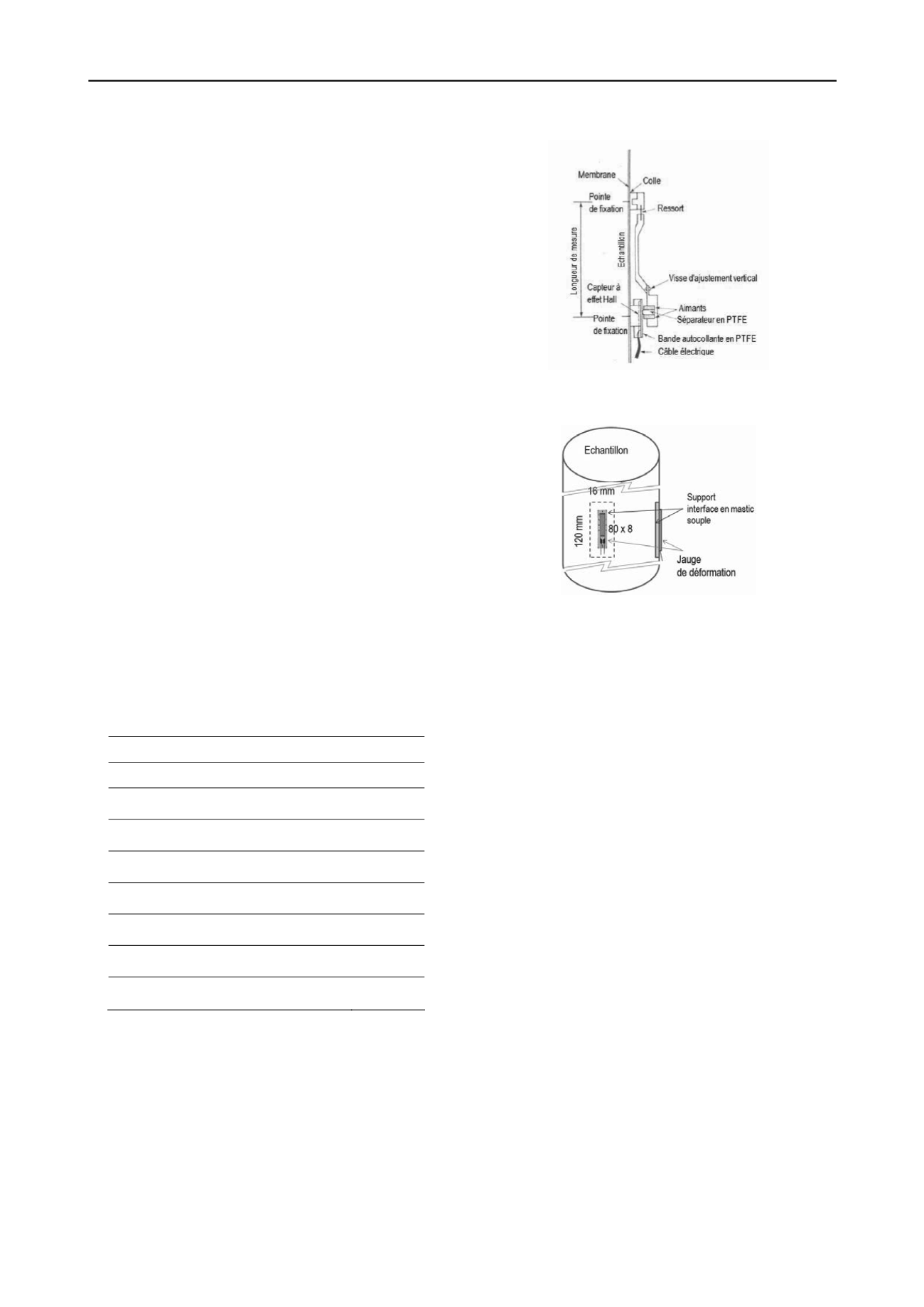
342
Proceedings of the 18
th
International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013
Proceedings of the 18
th
International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013
2 MATÉRIAUX ET MÉTHODE
2.1.Matériaux
Il s’agit d’un limon traité à la chaux provenant d’un remblai
expérimental compacté in situ.
La chaux utilisée est une chaux vive calcique CL 90-Q fournie
par Lhoist, conforme à la norme EN 459-1.
Les caractéristiques physico-chimiques du matériau sont
résumées dans le tableau 1.
2.2.Méthodes
Pour la mesure du comportement du matériau en petites
déformations, deux techniques expérimentales ont été testées:
La première technique est basée sur l’utilisation de capteurs
à effet Hall, composés d’une plaque dans laquelle on fait
circuler un courant électrique tout en mesurant la différence de
potentiel sur une ligne transversale à la circulation du courant
(Figure 1). Si un champ magnétique normal à la plaque est
appliqué, les électrons du courant seront déviés vers l’un ou
l’autre des points dont on mesure le potentiel, créant ainsi une
accumulation de charges en ce point et donc une tension
mesurable (Dufour-Laridan 2001).
La seconde technique est basée sur l’utilisation de jauges de
déformation. Il s’agit de composants électroniques ayant une
résistance variable en fonction de leur élongation dans la
direction de mesure. L’originalité de cette technique est que les
jauges sont collées à même le matériau. Le problème posé
habituellement avec les géomatériaux dont la nature granulaire
ne permet souvent pas de collage direct a été résolu en réalisant
à la surface du matériau une interface très souple dans la zone
de mesure sur laquelle vient se coller la jauge. L’interface est
composée d’un mastic étalé dans une rainure préalablement
taillée dans le matériau. La figure 2 présente un schéma de
principe de cette technique.
Tableau 1. Caractéristiques physico-chimiques du limon naturel et traité
la chaux
à
Limon naturel
Passants à 80
m (%)
98
Valeur de bleu de méthylène (g/100g)
2.50
Indice de plasticité (%)
7 à 8
Teneur en eau à l’échantillonnage (%)
17.9
Limon traité à 2.5% de chaux
Teneur en eau finale (%)
19.5
Densité sèche après compactage (g/cm
3
)
1.68
Taux de compactage (%
d OPN
)
97
3 COMPARAISON DES DEUX TECHNIQUES
Des essais ont été réalisés sur un échantillon prélevé depuis un
remblai expérimental constitué de limon traité à la chaux
compacté et âgé de 180 jours (Tableau 1). L’échantillon de 80
mm de diamètre et 160 mm de hauteur, est équipé des deux
capteurs de proximité pour la mesure locale de la déformation
axiale : deux capteurs à effet Hall et deux jauges de déformation
diamétralement opposées. Pris séparément, les deux capteurs à
effet Hall et les deux jauges donnent des réponses quasi
identiques. En revanche, on constate une différence de réponse
entre les capteurs à effet Hall et les jauges de déformation.
Figure 1. Principe de fixation d’un capteur à effet Hall sur l’échantillon
Figure 2. Principe de fixation d’une jauge de déformation sur
l’échantillon
Les résultats comparatifs entre la jauge et le capteur à effet
Hall sont représentés dans les plans [temps ; déplacement axial]
et [déformation axiale ; déviateur de contrainte], et ce, pour
deux contraintes de confinement différentes (Figure 3).
On constate pour les deux contraintes de confinement que le
capteur à effet Hall mesure des amplitudes de déformation plus
importantes que la jauge. Par ailleurs, on remarque que la
réponse de la jauge est quasi instantanée lors des cycles de
décharge-recharge, alors que le capteur à effet Hall affiche un
retard dans sa réponse matérialisé par des pics légèrement
arrondis dans le plan [temps ; déformation axiale],
contrairement aux pics vifs des jauges. L’interprétation de ces
résultats dans le plan [déformation axiale ; module d’Young]
(Figure 4) montre que les modules élastiques donnés par la
jauge sont nettement supérieurs (environ trois fois) à ceux
donnés par le capteur à effet Hall. Par ailleurs, la mesure des
vitesses de propagation des ondes sonores sous confinement nul
donne un module du même ordre de grandeur que celui donné
par la jauge.
Ce constat permet de remettre en cause le bon
fonctionnement du capteur à effet Hall. En effet, la fixation de
ce capteur est basée sur l’introduction d’épingles métalliques
dans un matériau compacté et rigidifié après 180 jours par le
traitement à la chaux. Cette opération est délicate et génère
généralement des trous de diamètre légèrement supérieur à celui
des épingles, ce qui se traduit par un léger jeu des points de
fixation qui peut avoir des conséquences importantes sur la
réponse du capteur.
Dans ce qui suit, nous avons sélectionné et retenu le capteur
basé sur les jauges de déformation et qui semble plus fiable et
conforme aux mesures des vitesses des ondes sonores.
4 RÉSULTATS
Ces résultats concernent des essais triaxiaux en petites
déformations à teneur en eau constante sur des échantillons non
saturés. Les contraintes de confinement varient de 0 à 300 kPa.
Pour chaque contrainte de confinement, des chargements
cycliques sous des déviateurs de plus en plus importants avec