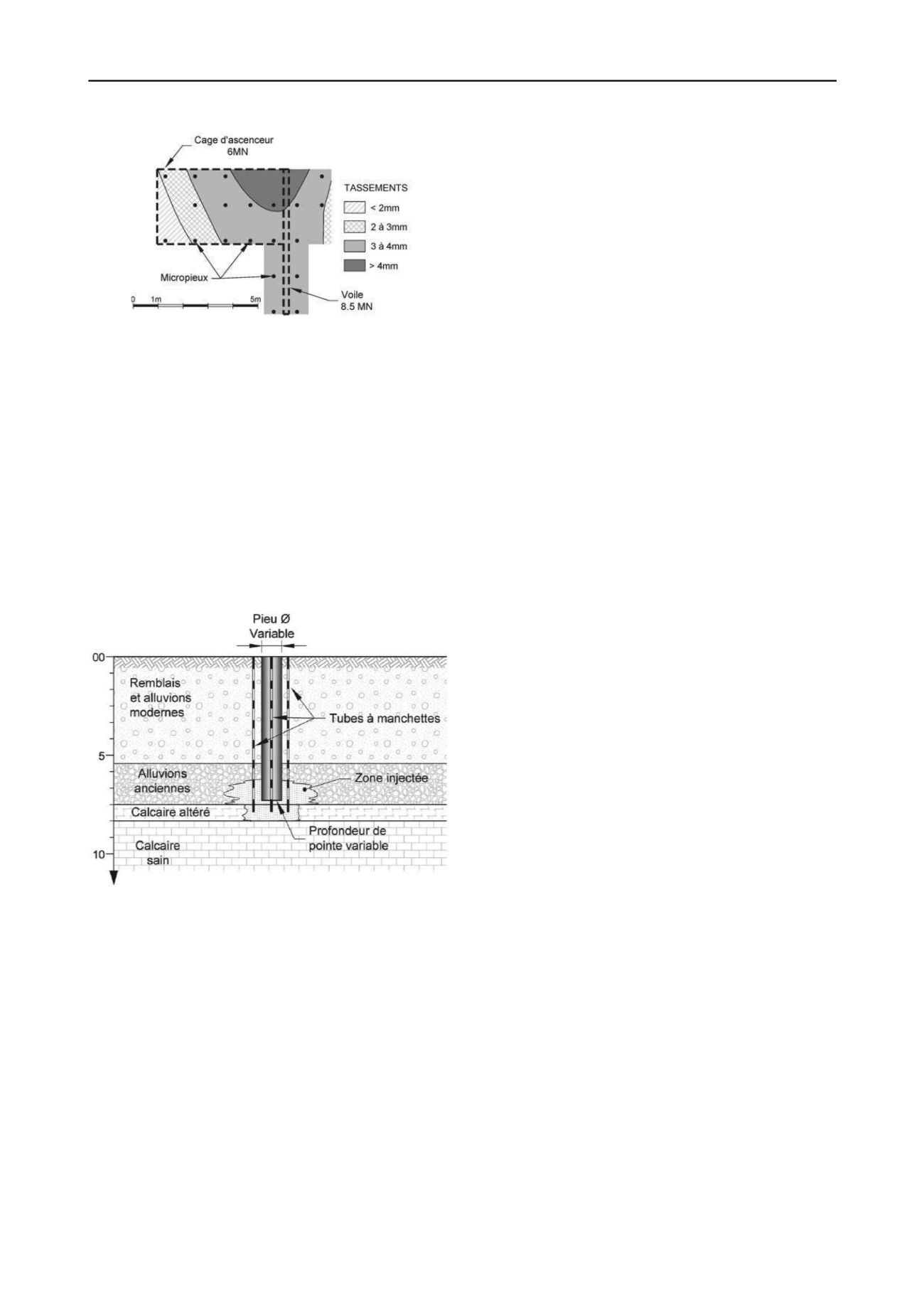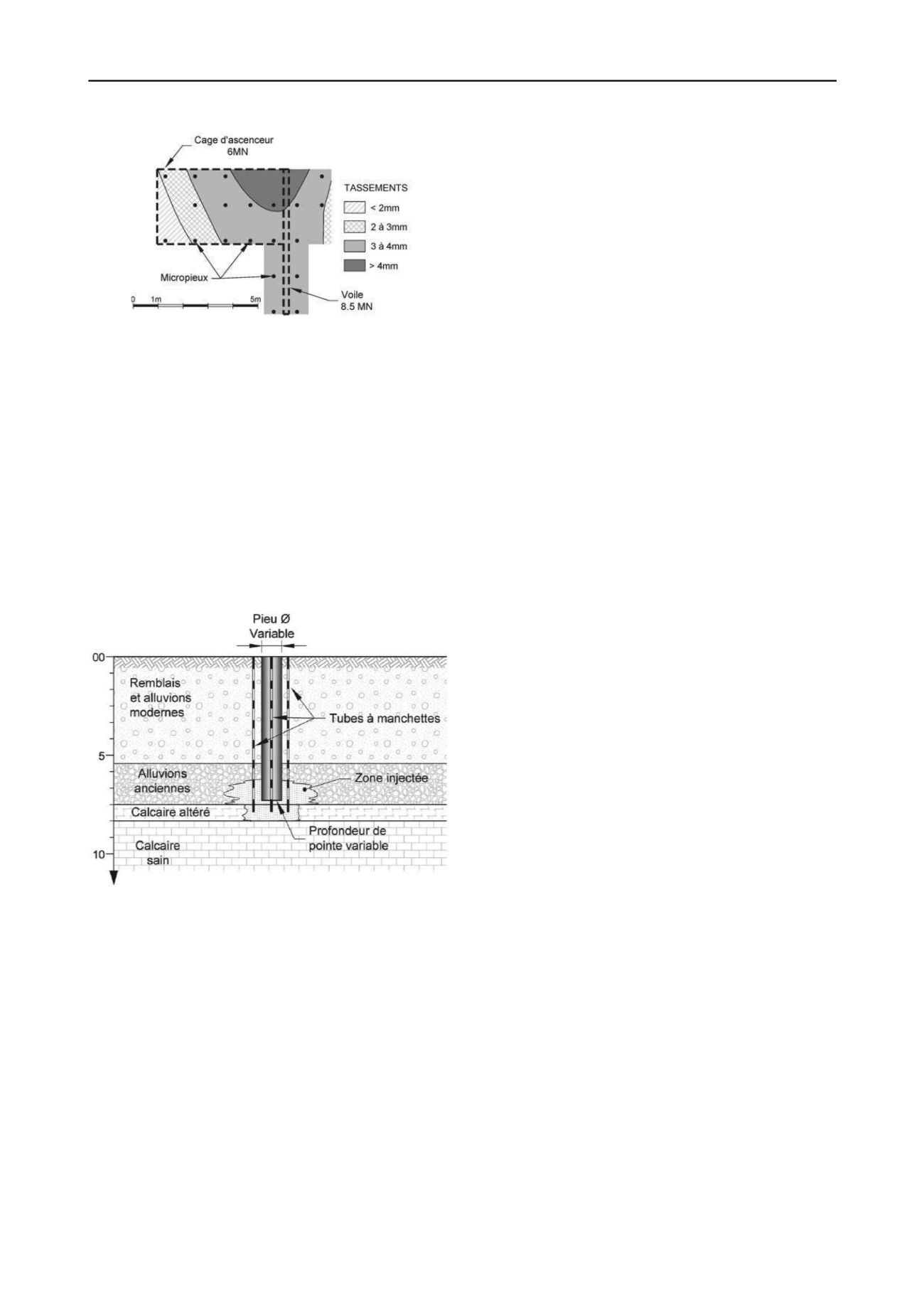
3209
Technical Committee 307 /
Comité technique 307
Figure 2
:
Carte de tassements calculés
3 RÉHABILITATION DU SECTEUR EST DU CAMPUS
DE JUSSIEU
Pour ce projet, la problématique était assez différente, dans la
mesure où la construction nouvelle n’apportait pas de
suppléments de charges sur les fondations par rapport à la
construction ancienne. Les bâtiments datant des années 1970 se
sont avérés fondés sur des pieux de 0.5 à 0.8 m de diamètre et
d’environ 8 à 9 m de profondeur.
La Figure 3 montre que les pieux traversent 4 à 7 m de
remblais et alluvions récentes limoneuses, puis 3 à 4 m
d’alluvions anciennes sablo-graveleuses, de façon à venir
« s’ancrer » sur l’horizon sous-jacent de calcaire grossier. Mais
en pratique cet ancrage n’est pas toujours assuré, et la portance
des pieux est donc variable.
Figure 3 : coupe type des terrains et des principes de confortement
Ainsi dans le cadre de la réhabilitation de ce bâtiment, il a
fallu « remettre à niveau » les niveaux de sécurité des
fondations des différents appuis, ce qui a conduit à développer
une méthodologie de projet suivant les différentes phases
suivantes :
1. Des investigations des pieux existants, par exploitation
des données d’archives et des puits de reconnaissance pour en
déterminer le diamètre, complétées par méthodes géophysiques
(impédance mécanique et sismique parallèle) pour en
déterminer la longueur. Ces investigations ont montré que les
pieux descendaient « plus ou moins » jusqu’au calcaire grossier,
mais pas toujours avec un ancrage suffisant.
2. Des reconnaissances géotechniques et une réévaluation de
la portance des pieux, avec les méthodes et moyens
« modernes », afin de déterminer quels étaient les pieux à
renforcer : essais pressiométriques de qualité, plots d’essais de
traitement de terrain par injection sous la pointe, essais de
chargements statiques de pieux avant et après injection, puis
enfin calculs de pieux avec une approche en déformations et pas
seulement en capacité portante, et enfin comparaison entre les
résultats des modélisations et ceux des essais en vraie grandeur.
Ces premières comparaisons montraient en général que le
comportement réel des pieux avant injection était beaucoup plus
favorable que prévu, ce qui a conduit à faire de nombreuses
retro-analyses pour finalement conclure à la nécessité de
majorer les hypothèses géotechniques de frottement latéral par
rapport aux règles usuelles.
Par ailleurs lors des essais de chargement après injection en
pointe de pieu, l’un des pieux d’essai s’est rompu,
correspondant à un dépassement de la contrainte admissible du
béton du pieu, tandis que l’autre a montré un comportement
largement amélioré par rapport à celui avant injection.
Cet ensemble d’essais et modélisations a permis de préciser
quels étaient les pieux à renforcer, à valider la méthode de
renforcement par injection sous la pointe, et à définir des
hypothèses de calculs réalistes pour le projet final.
3. une revue des différentes méthodes de renforcement des
pieux existants, micropieux, jet-grouting, injection en masse.
Une analyse des avantages et inconvénients de chaque procédé
a été conduite selon une approche multicritère, intégrant les
conditions de mise œuvre, les risques de désordres sur la
structure existante lors de leur mise en œuvre, la fiabilité du
résultat, et bien sûr les coûts et délais
Ces approches ont conduit à retenir finalement la solution de
traitement par injection en masse (Figure 3), validée par des
plots d’essai qui ont été rigoureusement suivis, et complétée par
des essais de chargement des pieux avant et après injection.
L’ensemble de la démarche, avec notamment des approches
du comportement des pieux en déformations, a permis de
réduire au stade projet d’environ 30 % le nombre total de pieux
à traiter (environ 480). Les études détaillées d’exécution
devraient encore conduire à une réduction très importante de
fondations traitées.
4 RÉHABILITATION EN DATA CENTER D’UN ANCIEN
CENTRE DE TRI POSTAL À PANTIN
Il s’agit toujours de la même problématique que pour les projets
précédents : réhabiliter un bâtiment existant R + 5 avec un
niveau de sous-sol, construit en 1973 et d’une emprise de 160 x
50 m, fondé sur 250 pieux environ, et qui devait être transformé
en Data Center, avec une forte augmentation des descentes de
charges.
Le contexte géologique comporte environ 6 m de remblais
et limons, surmontant 3 à 4 m de marnes infra-gypseuses puis le
calcaire de Saint-Ouen, les pieux étant ancrés dans l’un ou
l’autre de ces deux derniers horizons,
Comme pour les cas précédents, la démarche suivie à
conduit à identifier la géométrie des pieux existants et leur
capacité portante. En l’absence de données d’archives, il a été
procédé à des investigations des pieux existants par forages et
méthodes géophysiques, qui ont permis d’établir la base de
toute l’approche de conception de réutilisation des pieux
existants, à savoir leur géométrie : il s’avère que leur diamètre
est de 1.2 m et que leur profondeur est variable entre 9 et 11 m
environ, c'est-à-dire que leur pointe se situe au voisinage de
l’interface Calcaire de Saint-Ouen / sables de Beauchamp.
La vérification de la résistance à la compression simple R
c
du béton des pieux a été faite par prélèvement de carottes de
béton et essais sur échantillons. On a ainsi pu vérifier que le
béton des pieux était de très bonne qualité avec des valeurs
moyennes de R
c
de l’ordre de 40 MPa.
Enfin les analyses de la capacité portante des pieux existants
ont été faites à partir de nouvelles reconnaissances
géotechniques : il s’est avéré qu’une proportion importante des
pieux ne présentait pas la sécurité règlementaire. En effet les
premiers calculs montraient que, selon les normes actuelles, et
avec les hypothèses géotechniques déduites des essais, le