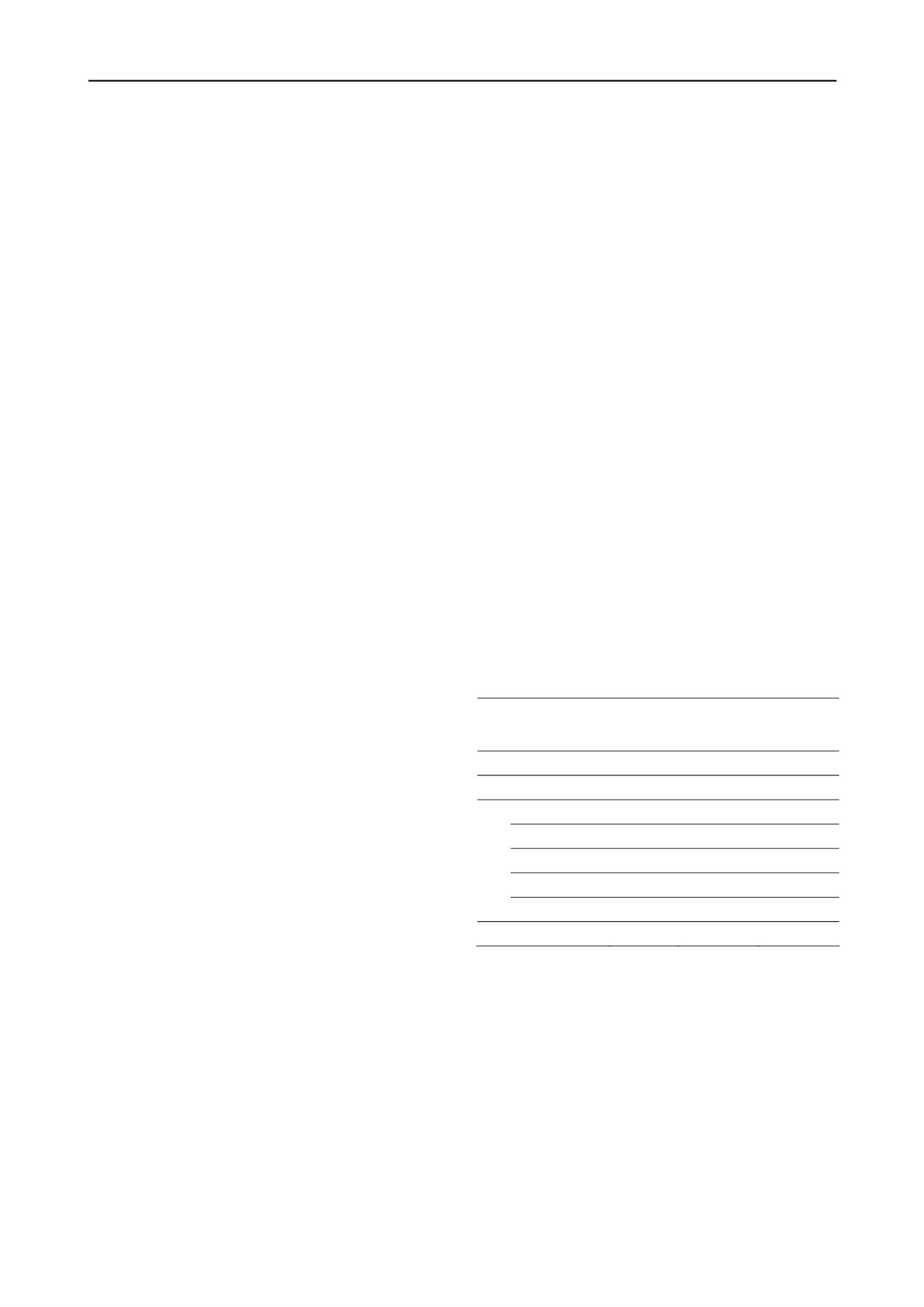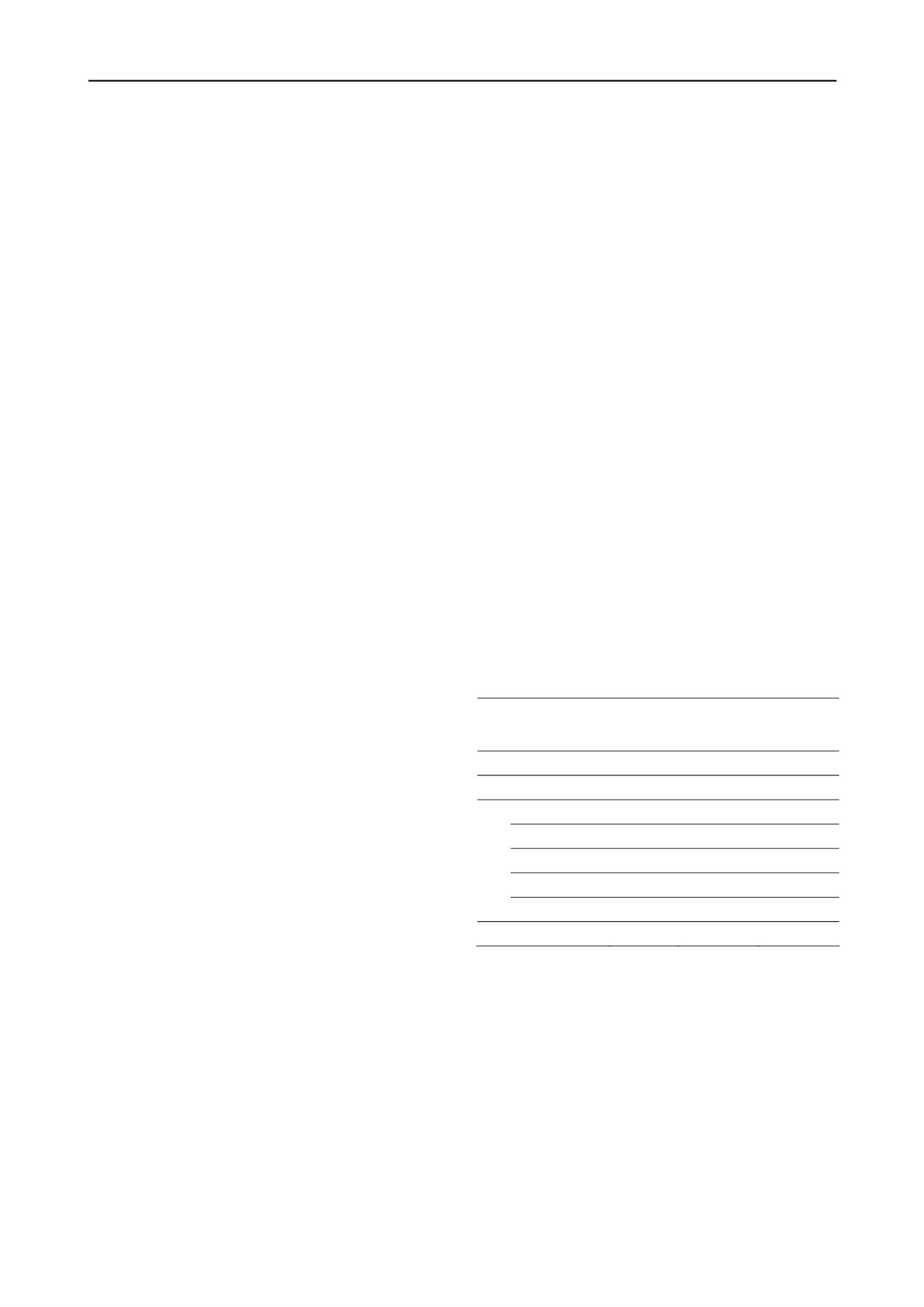
3181
Technical Committee 307 /
Comité technique 307
Dans le cas du traitement au produit enzymatique et à 2,0 % de
lignosulfonate, le compactage peut avoir lieu à une teneur en
eau de 11,5 % au lieu de 14,0 % ce qui représente une économie
d’eau de 44,5 m
3
pour 1000 m
3
de sol compacté.
Les résultats expérimentaux ont montré qu’il était possible,
grâce aux traitements, d’atteindre un objectif de compactage
donné pour une teneur en eau moindre ce qui permet de réaliser
une économie d’eau. Toutefois, les étapes de production des
substances utilisées, leur transport et leur mise en œuvre
génèrent des impacts environnementaux qu’il est nécessaire
d’évaluer sur l’ensemble des étapes du cycle de vie de
l’ouvrage. L’objectif principal de la partie suivante est ainsi de
définir dans quelle mesure les variantes traitées induisent une
réduction de l’impact environnemental global par rapport à la
mise en œuvre du sol non traité.
4 ANALYSE EN CYCLE DE VIE D’UN REMBLAI
TRAITÉ
La démarche appliquée est celle définie dans les normes
régissant l’analyse du cycle de vie. Le principe consiste à
quantifier les intrants pour un système donné puis à calculer
l’impact environnemental associé grâce aux données
d’Inventaire du Cycle de Vie de ces intrants (ICV). L’impact
environnemental est alors évalué à l’aide d’une méthode de
calcul de l’impact. Au cours de cette étude, la méthode utilisée
par la norme NF P 01-010 (AFNOR, 2004) est appliquée.
4.1
Définition du système
Le système étudié est un remblai dont la masse volumique sèche
visée est de 1,78 Mg/m
3
. La teneur en eau initiale du sol est
supposée être de 9,0 % ce qui permet de se situer dans un
contexte où les traitements présentent les meilleurs avantages
(Figure 2). L’IPI minimal requis est fixé à 10 pour assurer une
bonne traficabilité des engins de chantier. L’unité fonctionnelle
choisie correspond à un volume compacté de 1000 m
3
.
Définir le système revient à différencier les processus qui sont
pris en compte dans l’étude et ceux qui en sont exclus. Au cours
de cette étude, une démarche comparative a été adoptée ce qui a
permis de réaliser un certain nombre de simplifications en ne
considérant que les étapes qui diffèrent entre les variantes. Par
exemple, l’ensemble des étapes préparatoires au chantier, les
étapes d’extraction ou encore de transport du sol n’ont pas été
prises en compte dans le calcul des impacts environnementaux
car ces étapes sont identiques pour toutes les variantes.
4.2
Calcul des intrants
Les intrants considérés sont l’eau, les produits de traitement et
les carburants. Les quantités des autres intrants (volume de sol
par exemple) sont identiques pour toutes les variantes ce qui
permet de les retirer du système.
La quantité d’eau requise est directement calculée à partir de la
différence entre la teneur en eau initiale et finale. L’ICV de la
production de l’eau dépend principalement de son origine. Par
exemple, l’eau peut être prélevée sur des réseaux d’eau potable,
dans des cours d’eau, ou encore être pompée dans un forage. Il
est également possible d’anticiper les besoins en eau du chantier
en créant des bassins pour y stocker les eaux de pluie. Compte
tenu de la diversité des approvisionnements possibles et du
manque de données statistiques relatives aux prélèvements
d’eau sur chantiers, l’impact environnemental associé à l’étape
de prélèvement de l’eau ne sera pas pris en compte et devra être
discuté dans une étude de sensibilité.
Les quantités de produit enzymatique et de lignosulfonate
requises sont directement calculées en considérant le volume de
sol à traiter et les dosages appliqués. L’ICV du produit
enzymatique n’est cependant pas disponible. Des hypothèses de
substitution ont donc été être prises. Il a notamment été montré
que le produit enzymatique possède des propriétés similaires à
celles du Sodium Dodécyl Sulfate, un tensioactif courant, et
qu’il agirait sur les sols selon un mécanisme similaire (Blanck
et
al.
2012). L’ICV du produit a donc été assimilé à celui du SDS
dont l’ICV est connu (Stalmans
et al.
1995, Hirsiger et Schick
1995).
L’ICV du lignosulfonate est issu d’une étude réalisée par
Modahl et Vold (2011) à partir des données obtenues pour une
usine située à Sarpsborg en Norvège.
Les étapes de transports consomment deux types de carburants :
du diesel pour les poids lourds effectuant les transports routiers,
et du fuel lourd pour les cargos chargés du transport maritime
nécessaire à l’importation du produit enzymatique depuis les
Etats-Unis. Connaissant la consommation de carburants
nécessaire au transport des différents intrants, l’ICV de cette
étape peut être calculé à partir des données du fascicule
FD P01-015 (AFNOR, 2006). Quant à la consommation des
engins de chantier, elles sont issues du retour d’expérience de
DTP Terrassement.
Pour chacune des variantes, les intrants calculés sont résumés
dans le tableau 1. Les résultats mettent par exemple en évidence
que les variantes traitées consomment moins d’eau par rapport à
la variante non traitée (44 500 L au lieu de 89 000 L). Pour le
traitement au produit enzymatique, la consommation du
pulvimixeur est deux fois moindre en comparaison avec la
variante non traitée car une seule passe suffit pour effectuer le
traitement contrairement à la variante non traitée où
l’humidification doit être réalisée en deux passes. Le traitement
au lignosulfonate nécessite quant à lui l’apport d’une masse de
35 600 kg de lignosulfonate dont le transport représente une
consommation de carburant estimée à 379 L.
Tableau 1. Comparaison des intrants du système pour les trois variantes
tudiées.
é
Intrant
Non traité
0,002 %
Produit
enzymatique
2,0 %
Lignosulf.
Eau (L)
89 000
44 500
44 500
Produit (kg)
-
35,6
35 600
Camion
-
2
379
Arroseuse
5,2
2,9
2,9
Pulvimixeur
456
228
456
Compacteur
30
30
30
Diesel (L)
Épandeur
-
-
2,9
Fuel lourd (kg)
-
0,7
-
4.3
Calculs des impacts environnementaux
Pour le traitement au produit enzymatique (Figure 3), le calcul
des indicateurs des 10 catégories d’impact proposés dans la
norme NF P 01-010 montre que la variante traitée présente des
impacts réduits dans 7 catégories sur 10 (consommation de
ressources énergétiques, épuisement de ressources naturelles,
consommation d’eau, changement climatique, formation
d’ozone atmosphérique, pollution de l’air, pollution de l’eau).
La consommation d’énergie est par exemple réduite de plus de
40 % et passe de 18,8.10
3
MJ à 10,7.10
3
MJ si le traitement au
produit enzymatique est mis en œuvre. Au contraire, pour trois
catégories, l’impact est augmenté, la production de déchets et la
destruction de l’ozone stratosphérique en tête, suivie de
l’acidification atmosphérique. Au-delà des valeurs calculées, il
est nécessaire de se poser la question du caractère significatif
des écarts observés. En effet, pour la production de déchets par