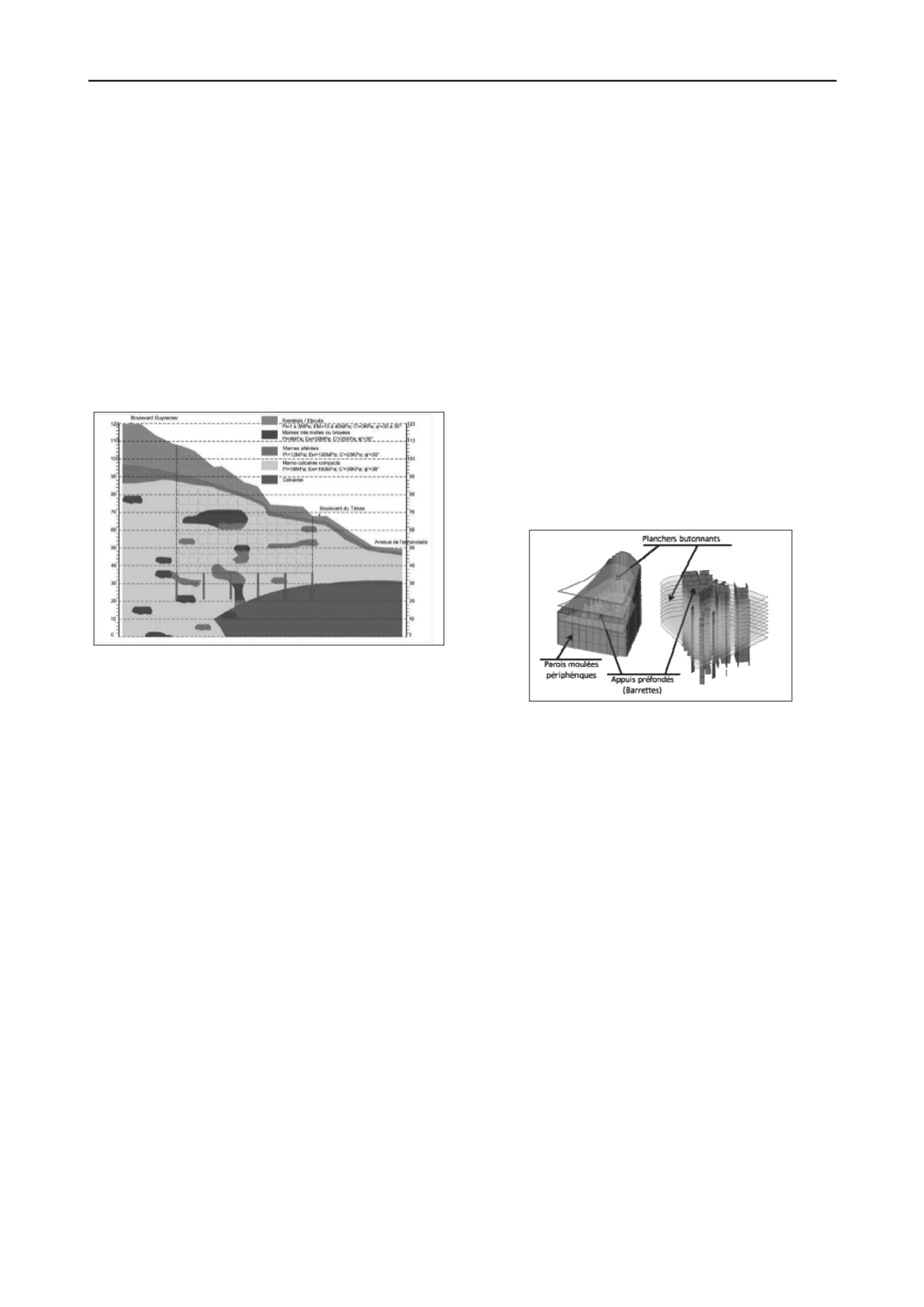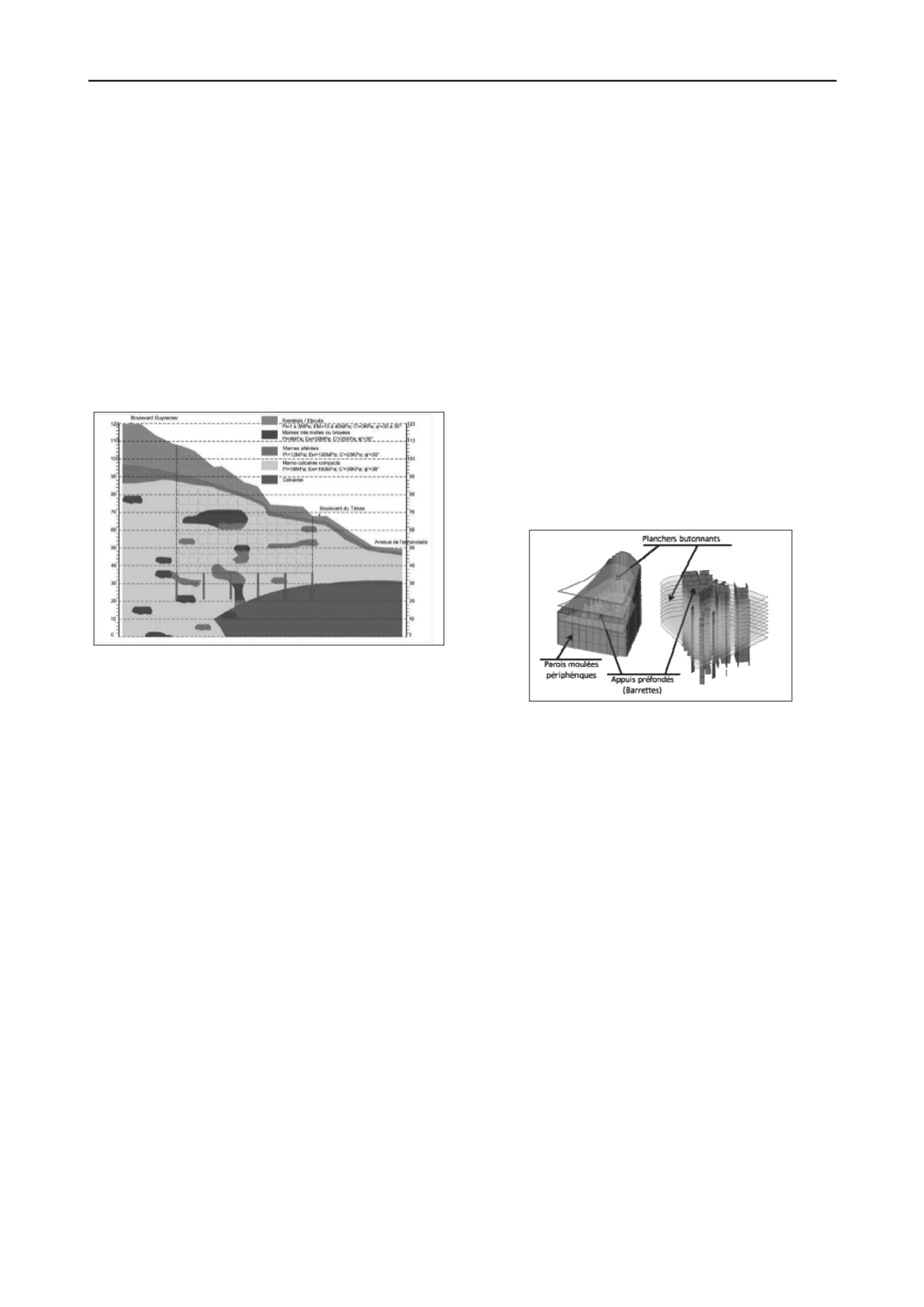
1932
Proceedings of the 18
th
International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013
ou moins altérées vers les profondeurs 35-50 NGM. La couche
marno-calcaire repose sur un substratum calcaire profond. Le
toit du calcaire dessine une surface chaotique et variable. Il se
situe en général sous la cote 30 NGM (Figure 3).
Le pendage général de la couche marno-calcaire (non
représenté ci-dessous) est dirigé de l’amont vers l’aval. Il est
donc favorable, lors de l’ouverture de la fouille, à la stabilité au
glissement du massif soutenu côté montagne.
Une grande partie des niveaux piézométriques varie entre
10 et 20 mètres sous le niveau du terrain naturel, avec des
fluctuations importantes qui atteignent fréquemment 4 à 5
mètres. Il s’agit d’une nappe superficielle qui coule à la surface
de la couche marno-calcaire. A cause de sa faible perméabilité,
cette dernière sépare la nappe superficielle d’une nappe plus
profonde qui baigne dans le calcaire avec un niveau
piézométrique situé environ 40 mètres plus bas que celui de la
nappe superficielle.
Figure 3: Coupe géologique, caractéristiques géotechniques
La bordure de la fouille est occupée par des bâtiments
publics ou privés à des distances plus ou moins proches de la
fouille. Compte tenu de la profondeur des excavations, un
certain nombre d’entre eux se situe dans les zones d’influence
des déplacements engendrés par les travaux d’excavation. Ce
voisinage impose des contraintes d'exécution, notamment en
termes du respect de déplacements admissibles.
3
OUVRAGES DE SOUTÈNEMENT: LES QUATRE
ELÉMENTS REMARQUABLES
Les dix niveaux d’infrastructure comportent des planchers
« butonnants » confinés entre les parois de la fouille. Ces
planchers n’ont pas de joints et peuvent donc transmettre entre
parois opposées les efforts de poussée ou de butée. La
superstructure se développe au-dessus du boulevard du Ténao
sur environ cinquante niveaux supplémentaires.
Si la stabilisation des parois de soutènement sous le
boulevard du Ténao peut être assurée au moyen d’un système de
planchers butonnants, ce n’est pas le cas pour les parois situées
au-dessus de ce boulevard, à cause de l’absence de terrain
offrant butée en vis-à-vis. C’est pourquoi les parois poussant au
vide ont été stabilisées à l’aide de tirants d’ancrage.
Par ailleurs, l’exiguïté et les contraintes d’accès au site ont
donné lieu à une solution de soutènement étagé des parois. En
effet, la configuration des lieux avant les premiers travaux
n’était pas défavorable à l’utilisation d’engins lourds. Ainsi, la
réalisation des premiers écrans de soutènement à l’aide d’engins
de taille réduite permet la réalisation de plateformes pouvant
recevoir des engins plus encombrants. C’est pourquoi les
premiers écrans de soutènement sont de type « mini-
berlinoise », passant ensuite à des écrans de type berlinoise,
avant de voir apparaître des écrans en paroi-moulée.
3.1 Une construction “Top-Down”
Deux objectifs principaux nous ont conduit à adopter cette
méthode de construction : a) Avantages offerts par des
planchers butonnants (Figure 4) comme solution plus sûre
d’équilibre des poussées en profondeur et dispositifs plus rigide
pour limiter les déplacements des parois, et, b) Gain de temps
dans la réalisation de la tour. En ce qui concerne ce dernier
point, il a été considéré que dans le délai nécessaire à
l’extraction des quelques 65 000 m
3
de terre des niveaux de
sous-sol et à la réalisation en « taupe » des 10 niveaux de
plancher correspondants, on pourrait construire simultanément
les 50 niveaux de superstructure. Pour atteindre cet objectif, il a
fallu réaliser des appuis préfondés de la tour avant le démarrage
de sa construction. Il s’agit des barrettes de fondation
d’épaisseur 1m, forées aux environs de la cote 70 NGM, après
les travaux d’excavation et de soutènement de la partie tirantée
des parois. Il est à noter que la contrainte de compression
moyenne développée dans ces barrettes par la tour en phase
d’exploitation s’approchera de la valeur de 10 MPa. Ce niveau
de sollicitation aurait pu rendre la solution non-faisable sans
l’évolution des textes réglementaires, évolution apparue avec la
mise en vigueur de la norme NF94-282 en février 2010, au
moment de l’élaboration de la conception.
Figure 4 : Parois périphériques, barrettes et planchers butonnants
Au fur et à mesure de la construction des structures, les
barrettes préfondées reçoivent des charges gravitaires alors que
les planchers de sous-sol, portés par les barrettes assurent le rôle
simultané de diaphragmes dans la transmission des efforts
horizontaux.
3.2 Une voûte en sol
La topographie et la géométrie de l’excavation ont été mises au
service de la conception du soutènement de la paroi la plus
profonde de la fouille, dans la zone où les poussées sont les plus
importantes du fait de la profondeur et de la pente du versant.
Mais la portée de la paroi dans cette même zone est plus courte,
ce qui nous a encouragé à en profiter pour inscrire dans le
terrain le funiculaire des poussées, évitant notablement de
solliciter la paroi profonde et limitant ainsi les déplacements.
On aurait pu penser, a priori, que ce funiculaire existait en soi
par le fait de la géométrie ("effet de voûte"). Mais cette
affirmation ne tient pas compte du trop grand déviateur des
contraintes (tangentielle et radiale), qui amène le sol de la
"voûte" à se déformer à l’état plastique. Pour profiter de l’effet
bénéfique de la voûte il a fallu ramener le sol qui la constitue à
état élastique.
Si la limite élastique dans le sol à l’arrière de la paroi n’est pas
dépassée à l’état initial, ce n’est pas forcément le cas avec
l’excavation des sols devant la paroi, qui augmente
progressivement la contrainte tangentielle dans le sol arrière.
Dans le cas où la contrainte radiale reste trop faible, le déviateur
s’agrandit et "pousse" le sol dans la plasticité qui engendre à
son tour des déplacements importants (Figure 5).