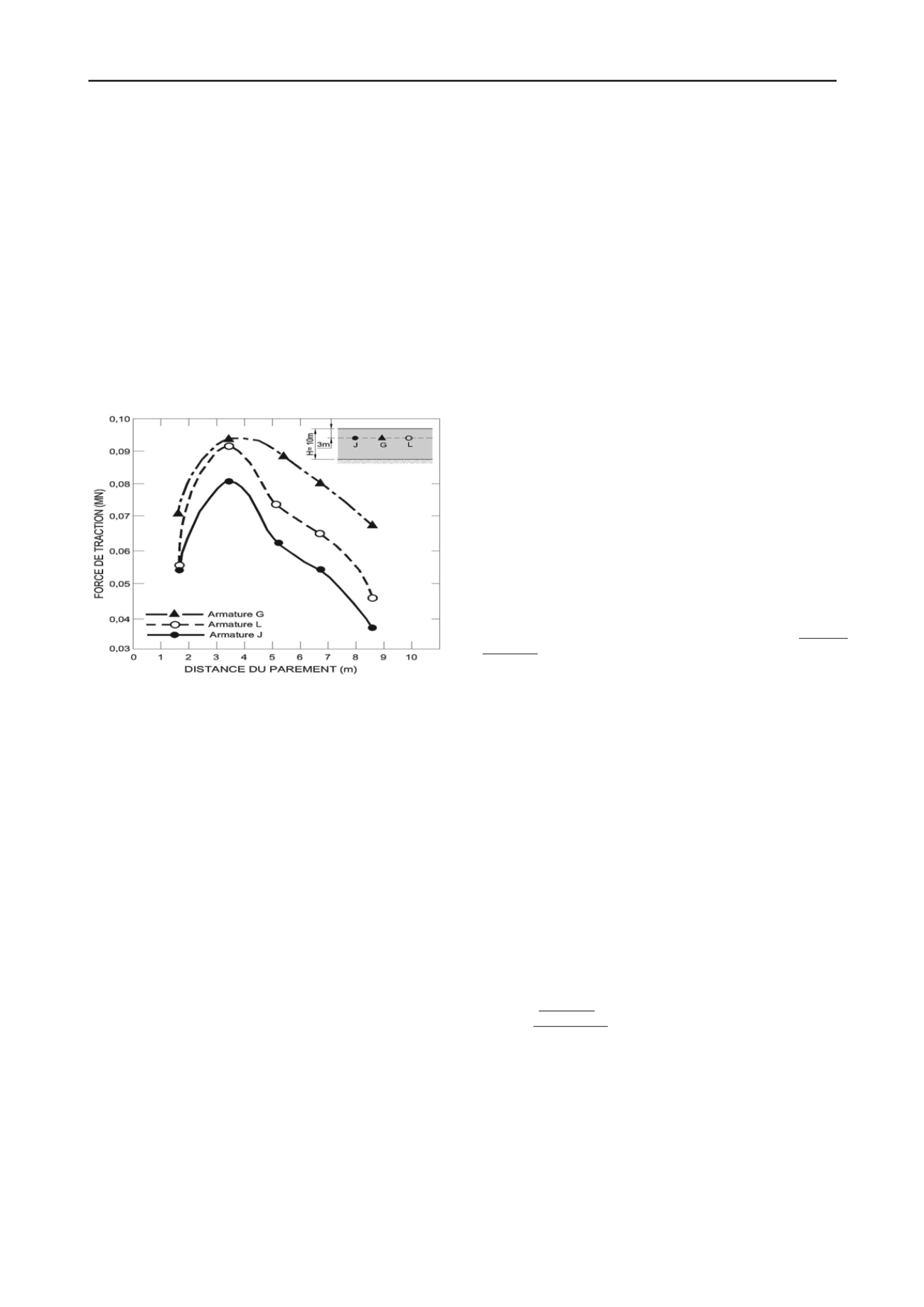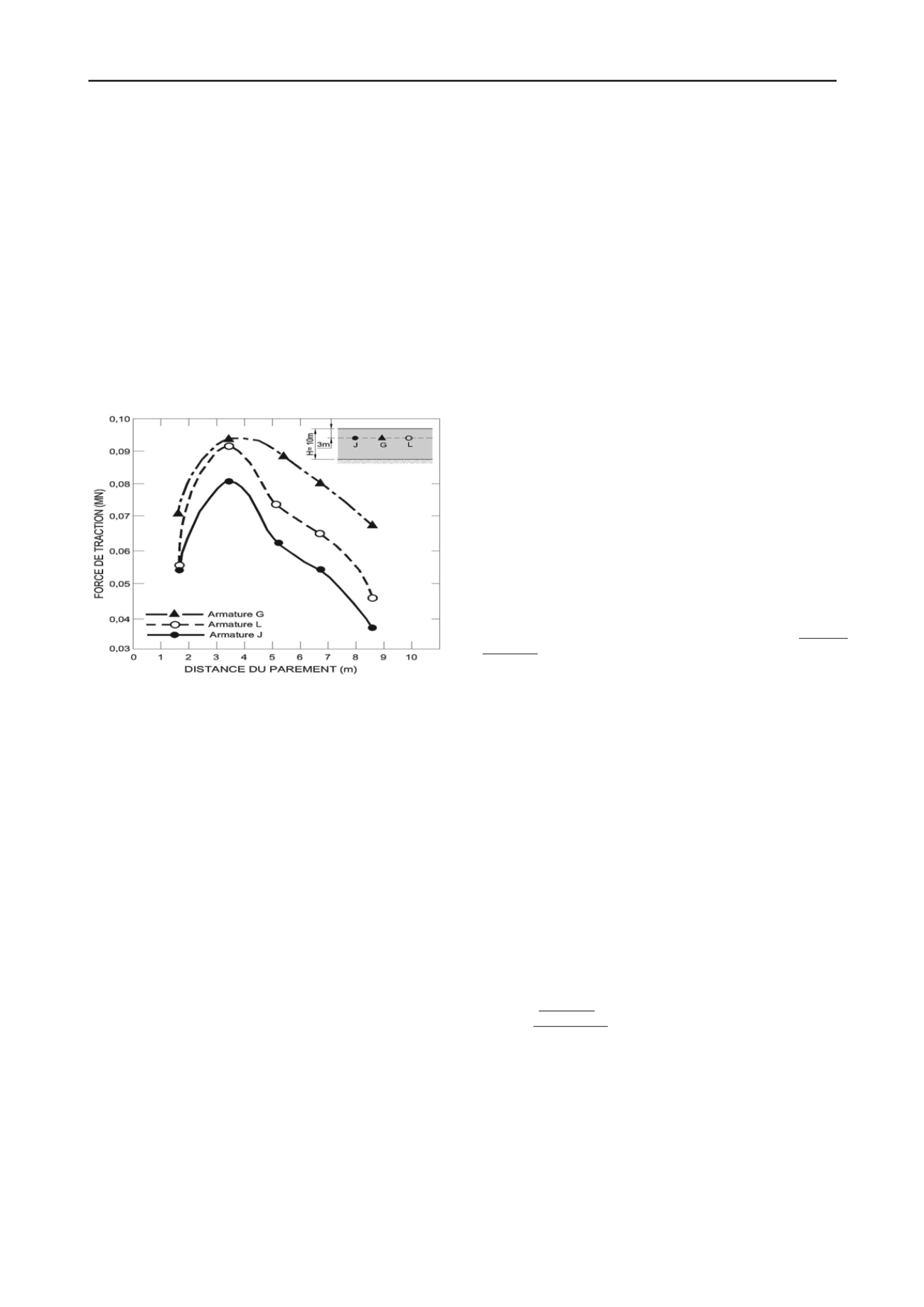
164
Proceedings of the 18
th
International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013
Proceedings of the 18
th
International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013
soutènement. Dans chacun des cas, un ou plusieurs ouvrages
expérimentaux en vraie grandeur étaient construits spécialement
pour cette recherche. Pour la stabilité des pentes, un versant
naturel instable avait été dédié à la recherche et largement
instrumenté, puis suivi pendant plusieurs années.
Des recherches sur la nouvelle technique de soutènement
française de la Terre Armée, inventée par Henri Vidal en 1963,
furent entreprises pour aboutir aux Recommandations et Règles
de l’art (1979) rédigées conjointement par le LCPC et le Service
d’Études Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA). Un
mur expérimental en Terre Armée fut construit en 1968 par le
Service des Ponts et Chaussées du département de l’Eure et
instrumenté par le LRPC de l’Ouest parisien. Il permit de
montrer pour la première fois que l’effort de traction dans les
armatures n’était pas maximal au parement, mais à une certaine
distance à l’intérieur du mur (Figure 1).
Figure 1. Expérimentation en vraie grandeur du mur en Terre Armée
d’Incarville (1968).Evolution de la force de traction dans les armatures
instrumentées d’un lit situé à 3m de profondeur.
Toutes ces recherches du LCPC et des Laboratoires
Régionaux étaient financées par le ministère de l’Équipement
dont dépendait le LCPC. Il n’y avait alors en France aucune
centralisation de la recherche en génie civil. Les universités
n’étaient pas associées à ces recherches et les grandes
entreprises, comme les grands services de l’état (SNCF, EDF,
etc.), effectuaient dans ce domaine leurs propres recherches.
C’était l’époque du début des autoroutes financées par l’État,
étudiées et construites par les Services des Ponts et Chaussées.
2 LA NAISSANCE DES PROJETS NATIONAUX
DE RECHERCHE EN GÉNIE CIVIL.
C’est à un ingénieur des Ponts et Chaussées, Michel Martin,
alors en service à la Direction des Affaires Étrangères et
Internationales (DAEI) du ministère de l’Équipement, que
revient l’idée des Projets Nationaux sur des recherches
expérimentales en génie civil, développée au tout début des
années 1980. Il s’agissait d’une part de permettre des projets de
recherche d’une assez grande ampleur, d’autre part et surtout de
rassembler sur un thème de recherche le plus grand nombre
possible de participants à la fois publics et privés.
Le principe consistait à demander aux participants une
cotisation financière pour chaque année de recherche, puis à leur
permettre de participer au financement des recherches sous la
forme d’apports en nature (temps passé, essais, mise à
disposition de matériel, etc.) et enfin à fournir une subvention
financière du ministère de l’Équipement égale à 15% ou 20 % du
montant total du projet. Deux thèmes furent choisis pour réaliser
une première expérience: les tunnels et la technique du clouage
des sols pour les soutènements. En dépit d’un certain scepticisme
au début, ces deux projets géotechniques, réalisés entre 1985 et
1989, furent un succès. Ainsi le PN Clouterre sur le clouage, qui
débuta en 1986 pour 4 années de recherches, a comporté 21
membres (7 organismes publics, 3 maîtres d’ouvrage publics et
privés, 11 entreprises). Son budget fut de 3,15 M€ dont 15%
apportés par la DAEI et 85% financés directement par les 21
membres avec les cotisations et les prestations en nature. La
gestion du projet fut assurée par un des partenaires : le CEPTP,
qui mit à la disposition du projet son site expérimental de St
Rémy lès Chevreuse.
Après ces deux premiers projets nationaux, il fut reconnu
nécessaire d’avoir une structure vraiment adaptée au caractère
collectif des PN pour en assurer la gestion, le suivi et également
la diffusion des résultats. C’est ainsi qu’a été créée, en 1989 et
de façon conjointe par le ministère de la Recherche et le
ministère de l’Équipement, l’Institut pour la Recherche et
l’Expérimentation en génie civil (IREX).
3 LA PROCÉDURE DES PROJETS NATIONAUX
DE RECHERCHE.
La procédure actuelle, qui vise à développer la recherche
appliquée et expérimentale en génie civil, a été initiée vers 1990
conjointement par les ministères de la Recherche et de
l’Equipement sur proposition d’un Conseil d’Orientation de la
Recherche en Génie Civil (CORGEC) comprenant des
représentants du monde de la recherche et du génie civil
Elle comprend tout d’abord la validation, par la Direction de
la Recherche du ministère de l’Équipement, d’un thème de
recherche proposé par la profession sur la base d’une étude de
faisabilité réalisée par un groupe d’experts animé par l’IREX.
Cette étude est rémunérée à l’aide d’une subvention du ministère
de l’Équipement, après avis d’un Comité d’orientation du génie
civil et urbain regroupant des chercheurs de l’Université et des
Centres techniques de l’État, ainsi que des représentants de la
profession.
À la suite de cette étude, l’IREX monte un dossier détaillé du
Projet National comprenant : le programme de recherche avec
ses expérimentations, la liste de ses partenaires publics et privés,
le planning qui s’étale en général sur quatre ans, le coût du projet
et son financement (cotisations, apports en nature, subvention du
ministère de l’Équipement entre 15 et 20%). Il est à noter que le
dossier doit toujours comprendre au moins un maître d’ouvrage
qui accepte de prendre totalement ou partiellement à sa charge
une expérimentation en vraie grandeur ou une instrumentation
très complète d’un ouvrage. Il est également demandé de prévoir
un poste de valorisation du projet pour réaliser une synthèse des
résultats, puis de la publier sous forme de recommandations ou
de guide. La plupart du temps, une version en anglais est
publiée. Les avancées techniques les plus marquantes font par
ailleurs l’objet de présentations dans les congrès internationaux.
Les Projets Nationaux ont couvert une large gamme du génie
civil:
1) les matériaux, essentiellement les divers types de béton ;
2) la géotechnique avec principalement les fondations ;
3) les procédés de construction ;
4) la réhabilitation et la maintenance ;
5) le développement durable
En 2009, à l’occasion de l’anniversaire des 20 ans de l’IREX,
un document de synthèse sur les Projets Nationaux a été publié,
intitulé « 20 ans de recherches appliquées et d’expérimentations
en génie civil ». Il donne, en 4 à 6 pages pour chacun des 26
Projets Nationaux, une description du projet et de ses retombées.
Nous nous intéresserons ici aux PN suivants qui se classent
dans la géotechnique ou qui s’y rattachent, soit :