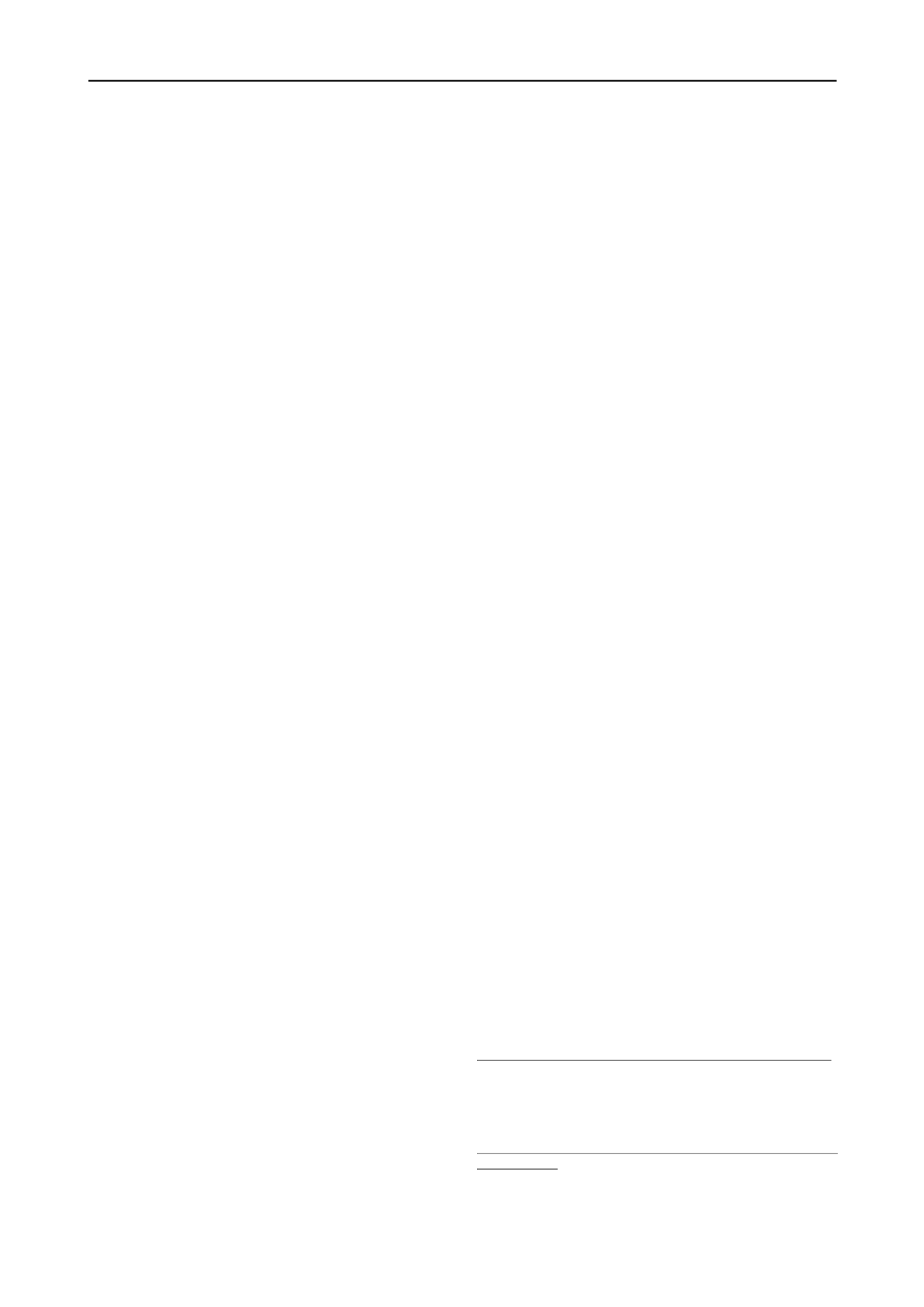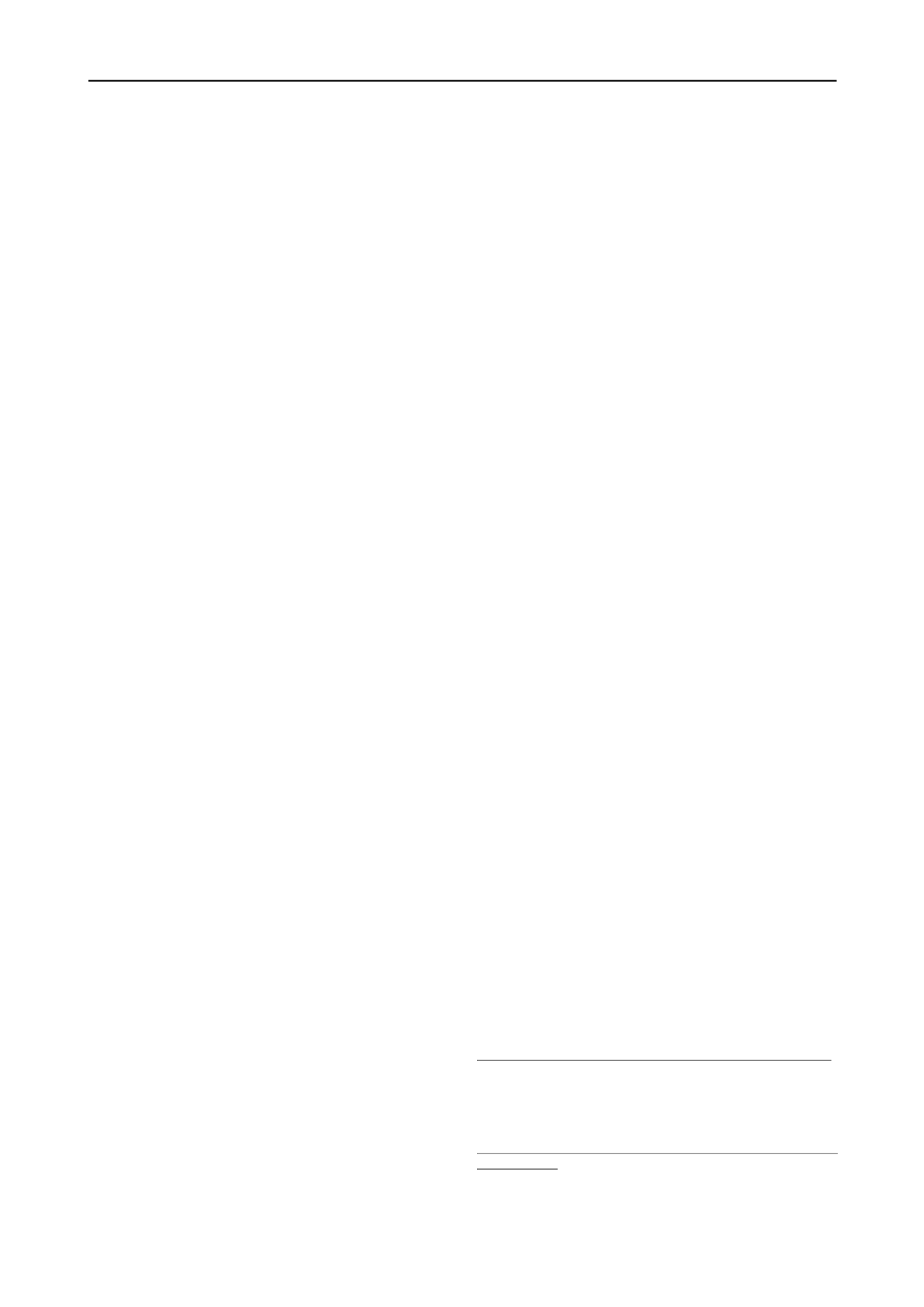
157
Special Lecture /
Conférences spéciales
Proceedings of the 18
th
International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013
Une procédure d’enquête publique sur un premier tronçon de
la ligne rouge (future ligne 15, entre Noisy-Champs et Pont de
Sèvres) a été lancée. Les premières mises en service sont
attendues à l’horizon 2020 sur ce tronçon.
La Société du Grand Paris
La Société du Grand Paris (SGP), Établissement Public de
l’État, a été créée par une loi de 2010. Elle est Maître d’Ouvrage
du réseau de transport public du Grand Paris Express. Sa
mission est de concevoir et de réaliser ce nouveau réseau. La
SGP a également une capacité d’aménager ou de construire
autour des gares.
La Société du Grand Paris est constituée d’équipes
pluridisciplinaires, avec notamment une direction du
programme qui regroupe des équipes de projet et des unités
métiers qui assurent une approche transversale. Avec plusieurs
dizaines de gares concernées par le projet, il est en effet
nécessaire de définir des règles communes et transversales de
conception. De la même manière, le projet étant essentiellement
souterrain et parfois assez profond, une équipe de spécialistes de
travaux souterrains intervient en conseil auprès des équipes
projet, elle définit et gère notamment les compagnes de
reconnaissance du sous-sol et du bâti à l’échelle du nouveau
réseau.
Le présent article vise à détailler la mission du Maître
d’Ouvrage durant les phases amont d’acquisition des données,
et comment ces données vont être utilisées et par quel acteur par
la suite.
La géologie du Bassin Parisien est plutôt bien connue et dès
les premières études du projet, le MOA disposait d’une base
documentaire sérieuse et assez étoffée sur les couches
géologiques intéressées par le projet (INFOTERRE). Il est bien
évident que cela n’est pas suffisant et que des campagnes de
reconnaissances ont dû être planifiées et dont certaines sont en
cours de réalisation.
S’ils servent d’abord à définir les paramètres servant aux
calculs de dimensionnement des ouvrages, ces résultats doivent
permettre aussi d’apprécier le comportement des terrains lors de
l’exécution des travaux et les conséquences sur
l’environnement, et en tout en premier lieu sur le bâti. La
typologie et l’état de ce bâti sont donc évidemment
déterminants pour juger des conséquences des travaux. Des
enquêtes détaillées du bâti seront donc entreprises. En attendant,
des investigations de terrain et documentaires ponctuelles, a
minima qualitatives, ont été effectuées toutes les fois que la
faisabilité de la réalisation des ouvrages du projet était en jeu.
Une bonne part des reconnaissances réalisées à ce jour a
permis d’alimenter les études de conception « amont », plus
particulièrement les études préliminaires qui se sont déroulées
tout au long de l’année 2012.
2. LES GRANDS AXES DE CONCEPTION
Dès les premières phases de conception du projet, la Société
du Grand Paris s’est donc attachée à recenser l’ensemble des
contraintes susceptibles d’interférer avec le projet : recherche
des réseaux enterrés ou infrastructures, établissement d’un
diagnostic des zones traversées tant du point de vue du sous-sol
que du point de vue de l’état du bâti (y compris réseaux enterrés
et infrastructures).
2.1
Le bâti, les réseaux enterrés et les infrastructures
2.1.1 Types d’ouvrages rencontrés à proximité du projet et
enjeux liés à leur présence
Le projet a potentiellement une influence sur différents types
d’ouvrages :
Bâti - tous les types de bâtiments sont présents. Leur
tolérance aux déformations du sol qui pourraient être
provoquées par l’exécution d’un projet de métro souterrain
dépend du type de construction et du type de fondations du
bâtiment.
Réseaux enterrés - seuls les réseaux de taille importante, ne
pouvant être déviés, représentent un véritable enjeu pour le
projet, à savoir notamment : les canalisations
d’assainissement, transports énergie (gaz, pétrole) et les
canalisations de chauffage urbain.
Infrastructures - sont notamment concernés les ouvrages
d’art et les infrastructures ferroviaires, routières.
Les effets négatifs sur les ouvrages existants liés à la
réalisation de nouveaux ouvrages enterrés sont bien sûr très
variables selon l’ouvrage concerné et son état. Ces effets vont
de l’atteinte au fonctionnement normal de celui-ci jusqu’à sa
dégradation voire sa ruine.
Cette plus ou moins grande sensibilité du bâti, des
infrastructures et des réseaux existants aux travaux de
réalisation du projet est également fonction de la nature et de la
qualité des terrains rencontrés et des éventuelles contraintes que
sont la nature du sous-sol, la présence de vides dans le sol ou de
décompressions préexistantes etc… ainsi que de la profondeur
du tunnel. Il est donc essentiel dès les premières phases de faire
un recensement de qualité, mission qui incombe à la Maîtrise
d’Ouvrage.
2.1.2 Organisation des études sur le bâti, les réseaux
enterrés et les infrastructures
Dès les phases amont
(études de faisabilité et études
préliminaires) conduites par le Maître d’Ouvrage, les réseaux
structurants (non déviables) ont fait l’objet d’un recensement
bibliographique en partenariat avec les différents
concessionnaires concernés : RATP, SNCF, égouts, transports
d’énergie, etc. De même, concernant le bâti, ont été recensés
les bâtiments susceptibles d’interférer avec le projet (immeubles
de grande hauteur, fondations profondes…).
Ainsi, les premiers tracés réalisés ont tenu compte, tant en
plan qu’en profil, de ces contraintes et n’interfèrent pas avec ces
grands réseaux ou obstacles.
Les études de maîtrise d’œuvre
à venir vont permettre
d’affiner les connaissances sur ce bâti, les objectifs sont
multiples :
confirmer et/ou compléter le recensement des études
préliminaires des grands réseaux non déviables, afin
d’établir un tracé prenant en compte l’ensemble de ces
contraintes ;
établir la méthodologie des travaux de confortement à
entreprendre en cas de proximité de ces grands réseaux ;
identifier, concevoir et initialiser les déviations de réseaux
en amont des travaux de génie civil pour les réseaux
déviables ;
caractériser le bâti dans la zone d’interférence du projet,
dans le but de déterminer sa sensibilité.
Pour atteindre ces objectifs, deux démarches doivent être
menées :
Le recensement systématique des réseaux présents sur le tracé :
Ce recensement porte sur l’exhaustivité des réseaux
(déviables et non déviables). Il permettra notamment de
caractériser les réseaux tant géométriquement (localisation en
plan et en profondeur) que qualitativement (nature, état de
conservation et fonctionnement des réseaux).
Une enquête sur le bâti et les infrastructures couplée à une étude
de sensibilité :
La Société du Grand Paris va s’adjoindre les conseils d’un
Assistant à Maîtrise d’Ouvrage en expertise du bâtiment. Cette