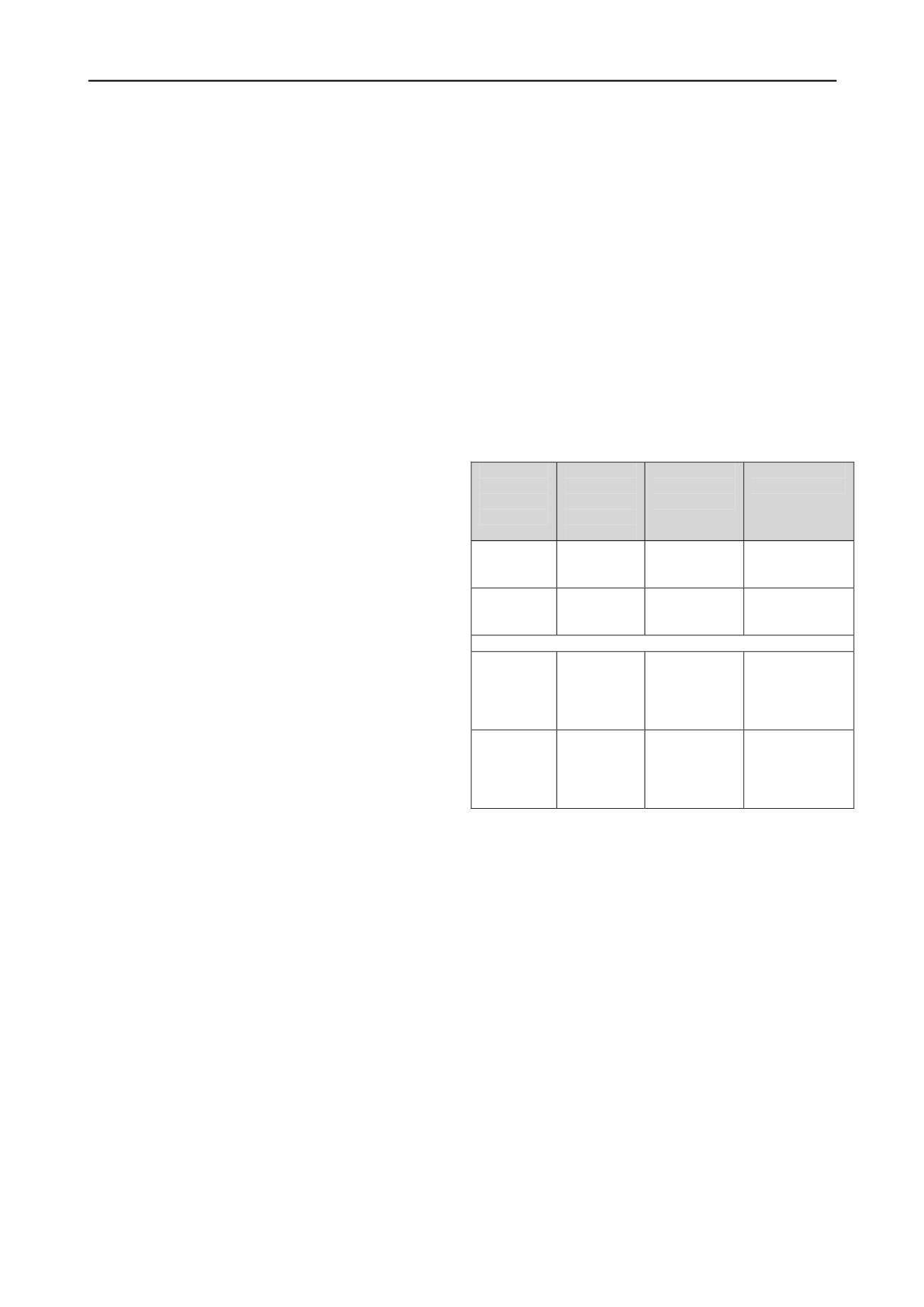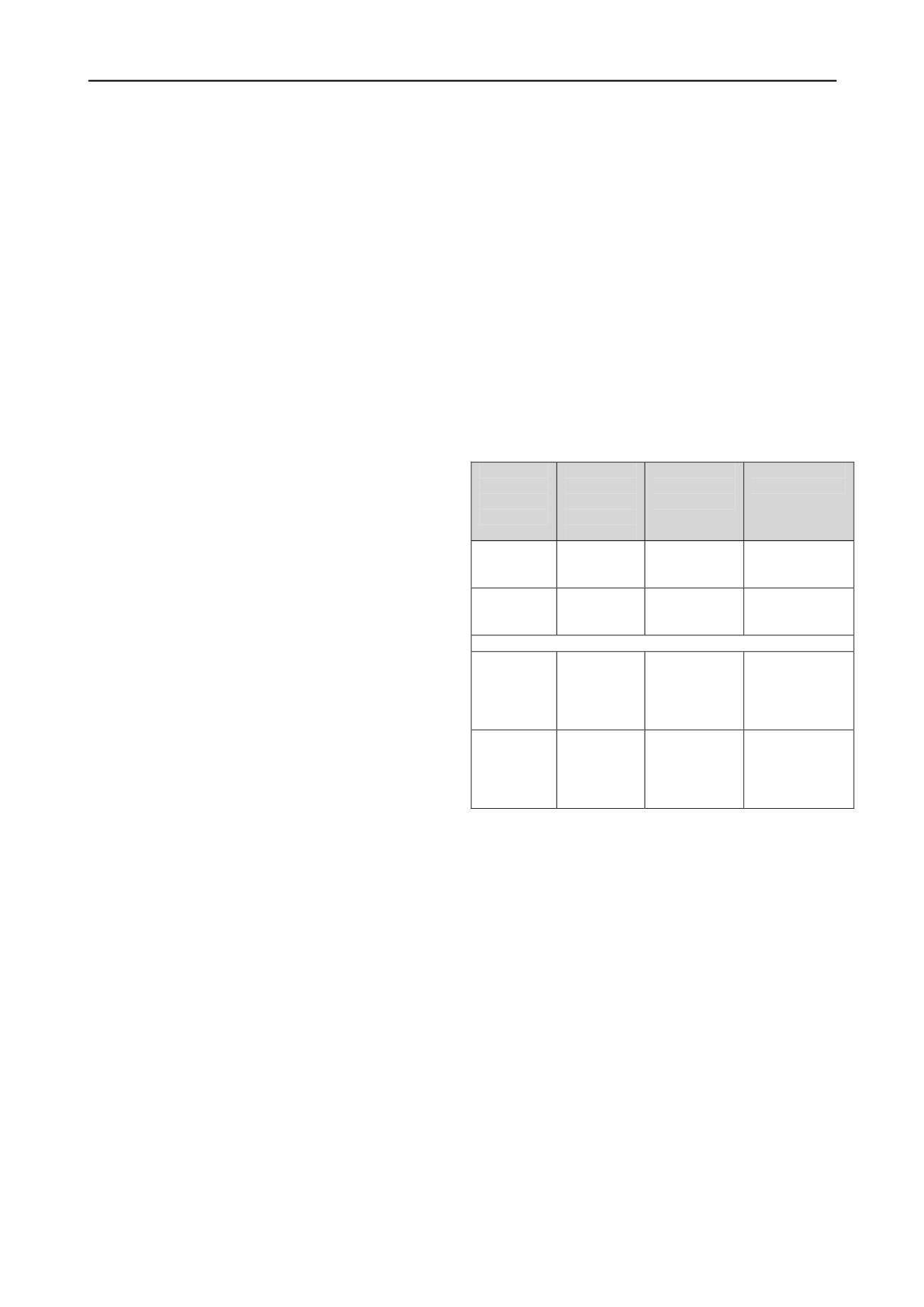
158
Proceedings of the 18
th
International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013
Proceedings of the 18
th
International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013
enquête et cette étude de sensibilité seront réalisées dans la zone
d’influence géotechnique du projet.
Elle aura un double objectif : reconnaître le bâti au sens large
tant d’un point de vue géométrique que structurel (niveau des
fondations, système de poutraison, etc.) ; mais également
déterminer sa vulnérabilité (tolérance aux déformations du sol)
aux travaux envisagés.
Ces données d’entrée seront ensuite fournies au Maître
d’Œuvre pour prise en compte dans la conception du réseau. Sur
la base de l’analyse de ces données, il conviendra d’adapter le
dimensionnement des ouvrages du métro et/ou les méthodes
constructives de manière à respecter les tolérances des ouvrages
existants afin de réduire voire supprimer le risque.
Le but de cette organisation est d’avoir un regard partagé sur
l’interprétation des données entre l’assistant à Maîtrise
d’Ouvrage bâti et le maître d’œuvre afin de concevoir un projet
adapté au contexte de sensibilité du bâti présent dans la zone
d’influence géotechnique. Dans cette organisation l’assistant à
Maîtrise d’Ouvrage Géotechnique a bien sûr un rôle essentiel à
jouer (cf.2.2.2).
De plus, la Société du Grand Paris dès les phases d’études de
Maîtrise d’Œuvre va mettre en place un Comité de maîtrise des
risques qui sera constitué d’experts indépendants. Ce comité
sera consulté sur les grandes orientations techniques du projet,
mais également sur les points sensibles.
A travers cette organisation tournée vers l’expertise des
sujets sensibles, dont fait notamment partie la caractérisation du
bâti pour la détermination des méthodes constructives, la
Société du Grand Paris entend maîtriser la qualité technique, les
risques, les coûts et les délais.
2.1.3 Dispositions mises en place en phase travaux
En complément, afin de vérifier que les mesures retenues
lors des différentes études réalisées permettent bien de
supprimer les risques d’impact sur le bâti, une auscultation de
celui-ci sera mise en place le long du tracé dans les zones
sensibles :
-
cette auscultation sera mise en place en amont des
travaux, afin de mesurer la respiration naturelle des ouvrages
liée notamment aux variations thermiques ;
-
en phase chantier, une surveillance de l’existant en
temps réel sera mise en œuvre, le but étant de comparer les
déformations estimées aux déformations observées afin de
pouvoir adapter les méthodes constructives immédiatement en
cas de déplacement jugé anormal.
Comme dans la phase de conception, cette auscultation fera
l’objet d’un double regard entre l’assistant à Maîtrise d’Ouvrage
en bâti et le maître d’œuvre, ainsi que d’une expertise
éventuelle du Comité de Maîtrise des Risques.
2.2
La géologie, l’hydrogéologie et la géotechnique
2.2.1 Le but des investigations géotechniques entreprises
Un projet de transport en souterrain est, par essence, en forte
interaction avec le sous-sol. De ce fait, afin de réaliser des
études de qualité, la connaissance parfaite du sous-sol au sens
large est nécessaire, les investigations géotechniques entreprises
dès la phase d’études préliminaires ont classiquement pour
objectifs :
-
D’établir le modèle géologique du projet : coupe
linéaire par corrélation entre les points de sondages.
-
D’établir
un
modèle
hydrogéologique.
Les
investigations doivent permettre de caractériser le ou les
aquifères en présence, tant d’un point de vue piézométrique que
d’un point de vue perméabilité.
-
De caractériser les couches rencontrées tant d’un point
de vue mécanique (dimensionnement les ouvrages de génie
civil) qu’environnemental (détermination de la destination
d’évacuation des déblais).
Le but final est de localiser et caractériser des zones dites «
homogènes» afin d’adapter les méthodes constructives à
chacune d’entre elles. Des zones singulières peuvent également
être identifiées (exemple zone de dissolution de gypse), qui
feront l’objet de reconnaissances spécifiques au regard de la
singularité rencontrée, permettant ainsi de mettre en place les
méthodes constructives et les confortements adaptés.
2.2.2 Organisation des études géotechniques
Les études géotechniques sont régies par la norme NF P 94-
500 relative aux missions géotechniques. Ces missions sont à
mettre en regard des phases d’études de conception définies par
la loi relative à la Maîtrise d’Ouvrage Publique « loi MOP », cf.
le tableau ci-après qui récapitule les caractéristiques de chacune
des phases :
Phases
d’études Loi
MOP
Phases
d’études
géotechniques
(NF P 94-
500)
Nature de la
donnée
Dossier à remettre
Etudes de
Faisabilité
Mission G11
Phase 1
Bibliographique
Premier modèle
géologique,
hydrogéologique
Etudes
Préliminaires
Mission G11
Phase 2
Reconnaissances
sur site
Première
identification des
risques.
Production du dossier d’enquête publique
Phase d’Avant-
Projet
Mission G12
Reconnaissances
sur site
Identification des
aléas majeurs et
principes généraux
pour en limiter les
conséquences
Phase Projet
Mission G2
Reconnaissances
sur site
Identifications des
aléas importants et
dispositions pour en
réduire les
conséquences
C’est toujours au travers d’une organisation rigoureuse,
permettant divers niveaux d’expertises, que la Société du Grand
Paris compte maitriser les risques techniques (dans un projet de
travaux en souterrain, ils sont essentiellement liés au sol), les
coûts et les délais.
Pour se faire, la Société du Grand Paris s’est adjoint les
conseils d’un assistant à maîtrise d’ouvrage en géotechnique,
qui a plusieurs missions :
-
Définir et superviser les investigations géotechniques,
-
Interpréter et établir pour le compte de la Société du
Grand Paris les missions G11, G12 et G2,
-
Accompagner la Maîtrise d’Ouvrage dans ses
discussions avec le maître d’œuvre.
Les résultats factuels de ces investigations géotechniques
sont transmis au maître d’œuvre pour une analyse et une
interprétation qui lui sont propres, ce qui double la réalisation
des missions G12 et G2.
Le but de cette organisation est d’avoir un regard partagé sur
l’interprétation des données de sols entre les spécialistes du
maître d’œuvre et l’assistant à maîtrise d’ouvrage
Géotechnique, afin de concevoir un projet adapté au contexte
géologique, hydrogéologique et géotechnique par une
adéquation des méthodes constructives retenues.
De plus, le Comité de maîtrise des risques, sera consulté
dans tous les grands choix techniques qui sont liés à la
géotechnique et aux méthodes constructives.