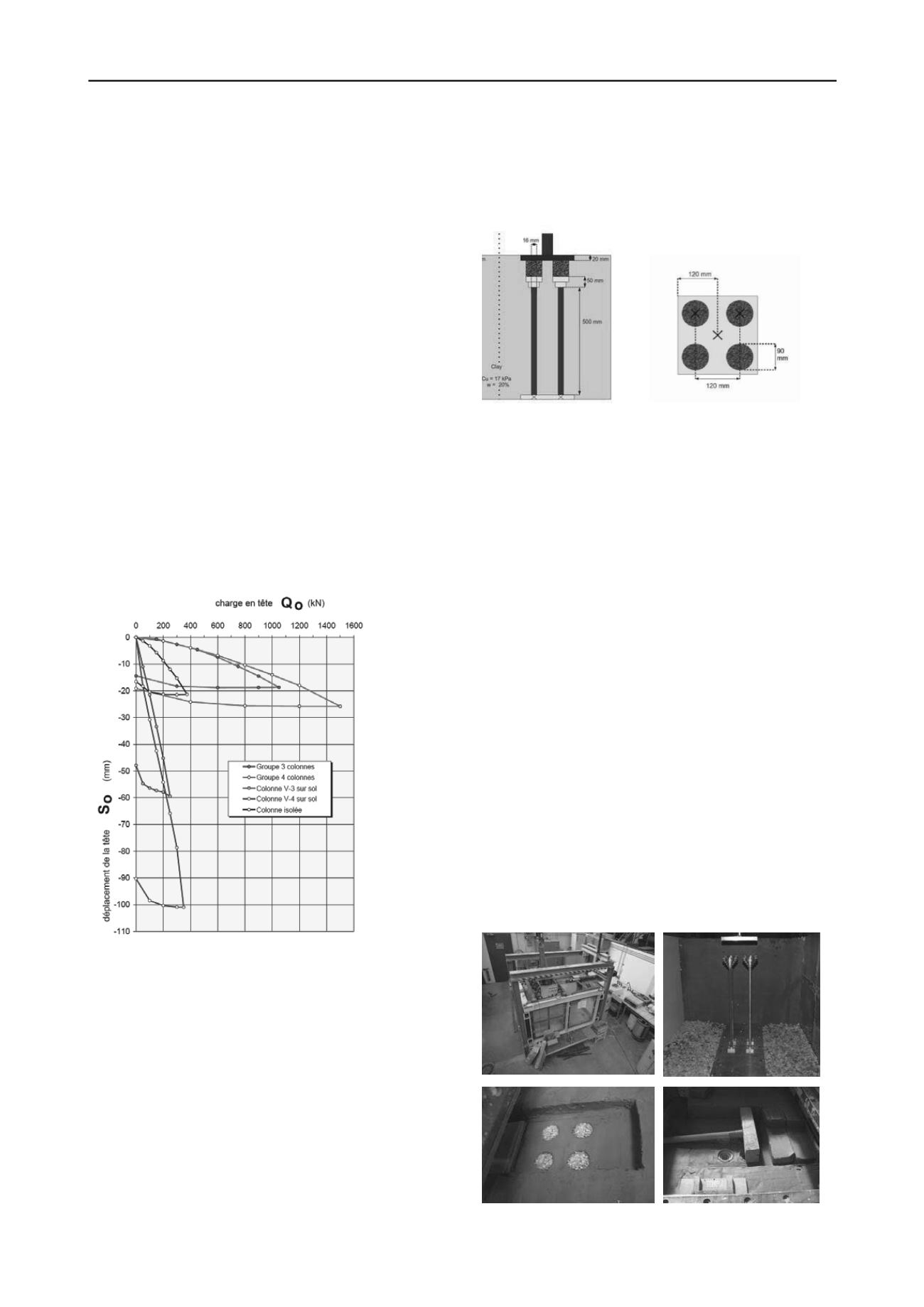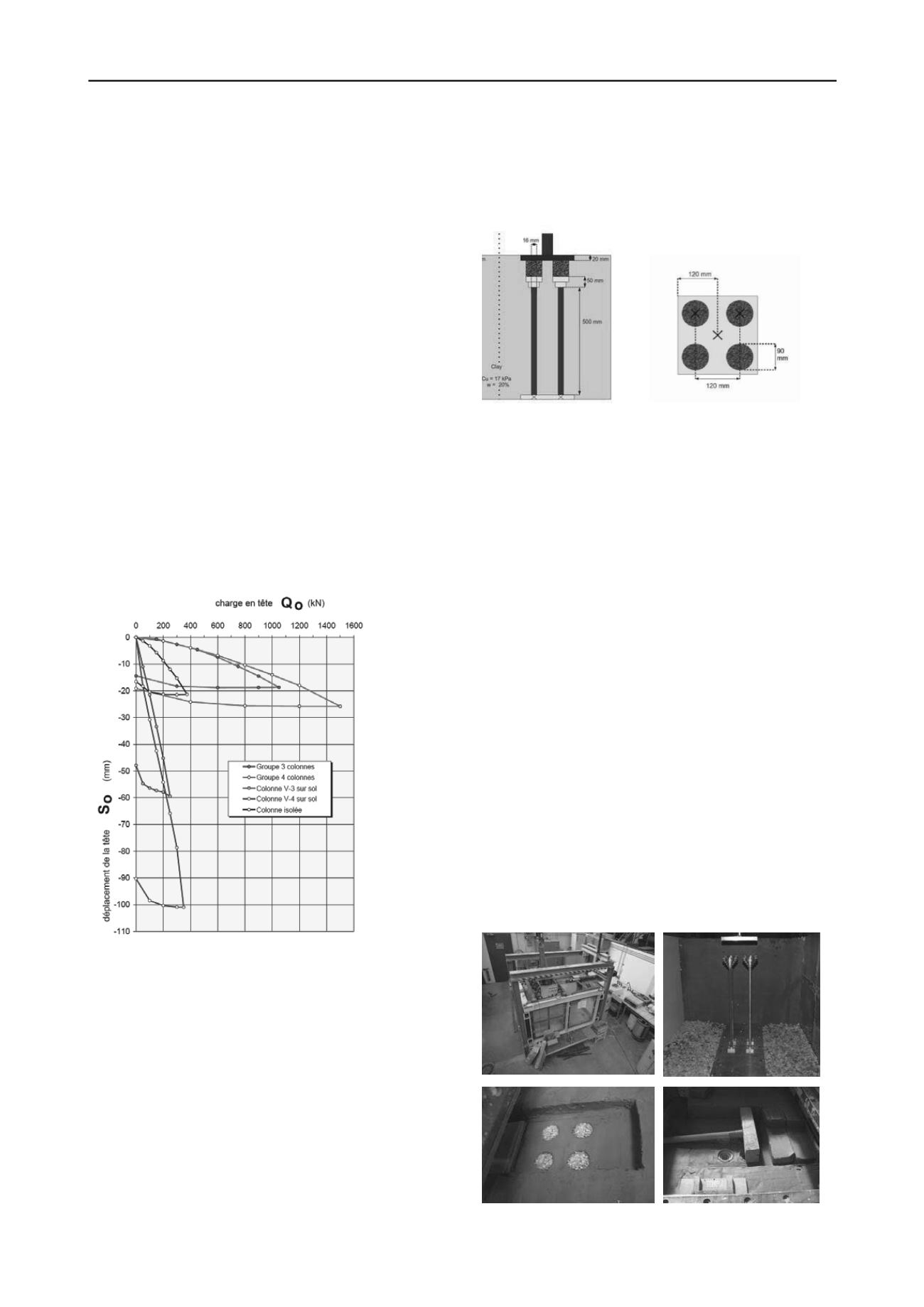
1528
Proceedings of the 18
th
International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013
2 PLOTS EXPERIMENTAUX DU LCPC
Il convenait d’étudier les différents aspects de la Colonne
Mixte, dans le cadre d’une recherche expérimentale sur site, en
vraie grandeur. Celle-ci a pu être réalisée à Niederbipp (CH), en
relation avec les travaux de confortement de la plateforme
logistique Center et à Saint-Martin-d’Hères (38) dans le cadre
d’un projet des bâtiments de logements confiés à Keller
Fondations Spéciales.
L’analyse des résultats recueillis a conduit aux conclusions
suivantes :
a) Les équipements de réalisation de la Colonne Mixte Keller et
le système de contrôle de mise en œuvre par enregistrement des
paramètres de forage et de bétonnage avec visualisation de
l’évolution de chacun d’eux, permettent un suivi efficace de la
confection de chaque colonne en temps réel.
b) l’observation des colonnes excavées a montré que la
continuité et la coaxialité de la partie gravier avec la partie
rigide sont respectées et maîtrisées dans le sens de la
répétitivité. La qualité du contact à la transition s’est avérée être
bonne.
c) la capacité portante réelle du sol renforcé par colonnes
CMM
®
est au moins trois fois supérieure à celle mesurée sur sol
vierge. En termes de tassement, le rapport de réduction des
tassements est de l’ordre de 4 à 5.
d) du point de vue de la prévision de la portance et des
tassements (Bustamante et al. 2006), plusieurs approches
analytiques (logiciel Greta de GETTEC) et numériques
(PLAXIS 2D et 3D) ont pu être validées.
Figure 2. résultats des essais sur sol vierge (courbes bleues) et du sol
renforcé par Colonnes Mixtes (courbes rouges).
3 ESSAIS EN LABORATOIRE
3.1
Présentation des modèles physiques
Un modèle réduit d’une semelle carrée de 24 cm de côté et de
2 cm d’épaisseur reposant sur 4 Colonnes Mixtes a été réalisé
au laboratoire 3S Grenoble. L’inclusion rigide est représentée
par un tube en aluminium de 16 mm de diamètre extérieur et 8
mm de diamètre intérieur fixé en pied. La zone de transition de
la Colonne Mixte est représentée par une tête élargie conique
remplie de gravier surmontée par une plateforme de transfert de
charge constituée soit par des colonnes en gravier, soit par un
matelas continu de gravier. Pour connaître l’influence de
l’épaisseur de la plate-forme de transfert sur les sollicitations
dans les inclusions rigides, les épaisseurs de 5, 8 et 10 cm ont
été étudiées. La semelle est encastrée dans le sol sur toute sa
hauteur. Pour l’étude des sollicitations latérales de l’inclusion
rigide, une inclusion est instrumentée avec 20 extensomètres
répartis sur toute la hauteur, de manière à représenter les profils
des sollicitations de manière détaillée.
Figure 3. Modèle mixte échelle 1/10 (Thèse Hana Santruckova 2012).
Dans le cadre de ce travail, la condition de similitude
rigoureuse n’est pas respectée pour le niveau de contrainte
(σ* = 1) pour les modèles réduits soumis à une gravité normale
(g* = 1). Néanmoins, cette modélisation physique a pour
objectif de visualiser le mécanisme d’interaction du complexe
sol-CMM
®
-semelle sous sollicitation horizontale et de calibrer
un modèle numérique.
3.2
Méthodologie expérimentale
Le dispositif expérimental est constitué d’une grande cuve
(VisuCuve) rigide et imperméable de 2 m de long par 1 m de
large et 1 m de profondeur, qui permet une visualisation latérale
des mécanismes. Elle est remplie par une argile saturée très
molle (voir figure 4). Un chariot de chargement supportant le
modèle de la semelle peut se déplacer le long de deux rails
parallèles fixés sur les deux côtés latéraux. Le modèle de la
semelle peut descendre librement sous le chargement vertical
grâce à un système de guidage sur le chariot de chargement. La
charge verticale qui reste constante tout au long de chaque essai
a été appliquée à l’aide d’un vérin vertical fixé sur le chariot.
Les forces horizontale et verticale sont mesurées par deux
capteurs de force montés sur le chariot de chargement et les
déplacements horizontaux sont mesurés par un capteur de grand
déplacement directement sur le chariot durant les essais quasi-
statiques, et par un LVDT sur la fondation pour les essais
dynamiques. Le déplacement vertical est mesuré par un LVDT
fixé sur le modèle de la fondation.
Un des quatre tubes représentant l’inclusion rigide constitue
le macro capteur instrumenté (voir figure 4). Les fils de
connections de ces jauges sortent par le pied du tube creux.
Figure 4. La « VisuCuve », la partie rigide+zone transition, mise en
œuvre de l’argile et du gravier de la partie souple.